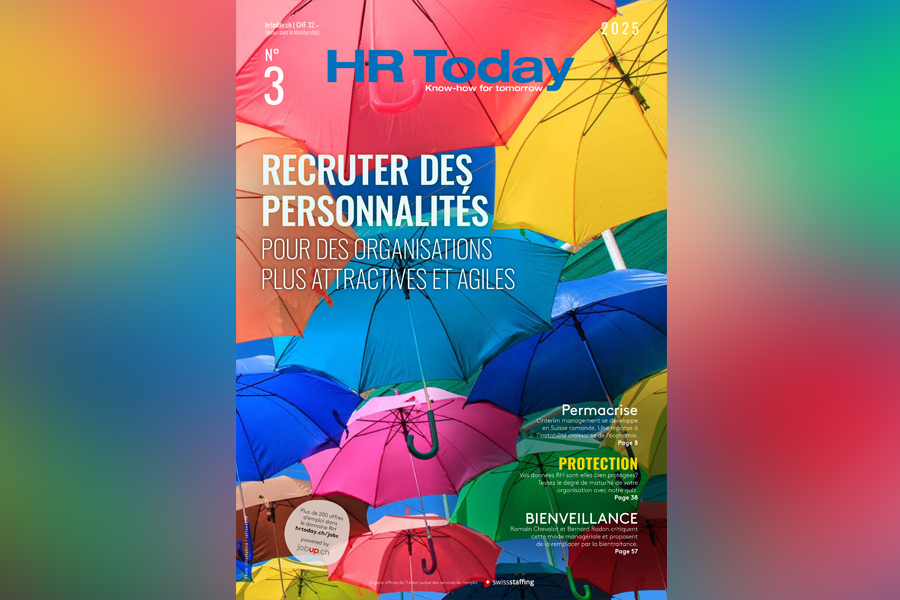En finir avec l'illusion de la bienveillance
Parmi les mots qui ont conquis les narratifs managériaux, la bienveillance figure en tête de liste. Elle est devenue omniprésente dans les chartes, les règlements d’entreprise, voire des séminaires de leadership. Mais à force d’être invoquée, cette notion a perdu de sa substance. Un autre terme, plus circonspect et plus opérationnel, la bientraitance, mérite que l’on s’y attarde tant il dessine une approche différente plus ancrée dans l’action des relations humaines en entreprise.

Photo: iStock
La bienveillance: une disposition d'esprit
La bienveillance renvoie d'abord à une intention. Être bienveillant, c'est adopter une posture intérieure tournée vers l'autre, faite de compréhension, d'écoute, d'indulgence. Une qualité morale, souvent associée à l'empathie ou à la compassion. Mais elle reste une attitude, pas nécessairement un passage à l’acte. On peut être bienveillant sans que cela se traduise concrètement dans les faits.
Et c’est là que le bât blesse. Car la bienveillance, aussi louable soit-elle, peut devenir source de confusion, voire d’angoisse pour les managers. Comment savoir si l’on a été «assez» bienveillant? Où commence l’exigence, où finit la complaisance? L’intention suffit-elle à garantir un climat de travail sain? «L’enfer est pavé de bonnes intentions», dit l’adage. Et il résonne particulièrement fort dans des organisations où le côté nébuleux du mot finit par désorienter les cadres.
La bientraitance: une pratique, un engagement
À l’opposé, la bientraitance peut être définie comme une démarche globale visant à promouvoir le respect des droits et la qualité de la vie des personnes. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de bonnes intentions, mais de mettre en œuvre les pratiques, les processus, les postures professionnelles, garants du respect de l'autonomie et du bien-être des personnes au travail. On comprend bien que la bienveillance est subjective et individuelle alors que la bientraitance est objective et collective. Elle suppose un cadre, parfois même une évaluation. Mieux: elle peut devenir une culture managériale à part entière. Une culture qui s’enseigne, se diffuse, s’évalue. Là où la bienveillance peut être spontanée, la bientraitance se construit.
Faire la chasse aux comportements déviants
À l'heure où la confusion entre posture et action fragilise les environnements de travail, il devient indispensable de redonner des repères aux organisations. La bientraitance offre un cadre pragmatique, mesurable et exigeant.
Cinq leviers concrets permettent aux DRH d'ancrer cette culture au cœur de l’entreprise:
1. Mettre en place des processus transparents et accessibles
Élaborer des règles simples, partagées par tous, permet de garantir que chacun se sente respecté et entendu. Un exemple: formaliser une procédure d'évolution professionnelle où les critères de promotion sont explicités et accessibles à tous les collaborateurs.
2. Installer des outils de veille sociale
Prendre régulièrement la température des équipes est un levier de prévention essentiel. Enquêtes, entretiens de climat social, baromètres de satisfaction internes: ces outils permettent d’anticiper les irritants, d’identifier les signaux faibles et d’agir avant qu’ils ne dégénèrent.
3. Garantir des conditions de traitement respectueuses et équitables
Il s'agit de traiter chaque salarié avec dignité, y compris dans les moments difficiles. Cela passe par des politiques sur l'égalité des rémunérations, un accompagnement respectueux lors des départs (outplacement, bonus de transition, congés de fin de carrière) et une attention réelle portée à l’équité perçue.
4. Former les managers à détecter et traiter les comportements déviants
La maltraitance passive naît souvent de l’ignorance ou de la passivité. Former les managers au discernement des comportements inappropriés, à l’écoute active et à la régulation des tensions est un acte de bientraitance à forte valeur ajoutée. Le courage managérial se cultive.
5. Créer une gouvernance RH alignée sur l’éthique
Mettre en place un comité d’éthique, désigner des référents de confiance, structurer des cellules de médiation indépendantes: autant de mécanismes qui renforcent la capacité de l'organisation à traiter rapidement et avec confidentialité les situations sensibles.
RH: responsables mais pas coupables
À l’heure où les relations au travail deviennent de plus en plus psychologisantes, la bienveillance, mal comprise, devient une injonction culpabilisante pour les managers et les collaborateurs. Cette injonction produit de la confusion, de la peur d’agir et une perte de repères. Revenir à des vecteurs plus pragmatiques comme la bientraitance est non seulement plus puissant, mais aussi plus juste. Parce qu’elle invite à l’action concrète plutôt qu’à l’introspection sans fin, la bientraitance replace l’entreprise dans son rôle: celui d’un lieu d’exigence respectueuse et non d’une thérapie collective.