Choisir un coach pour intervenir en entreprise: comment sortir du brouillard
Le coaching est devenu un véritable phénomène dans le secteur des services aux entreprises. Avec une forte concurrence entre les différents prestataires du marché suisse romand. Mais face à une multitude de références théoriques et de méthodes d’intervention, les DRH peinent à y voir clair. Les attentes des coachs et des entreprises sont ambivalentes.
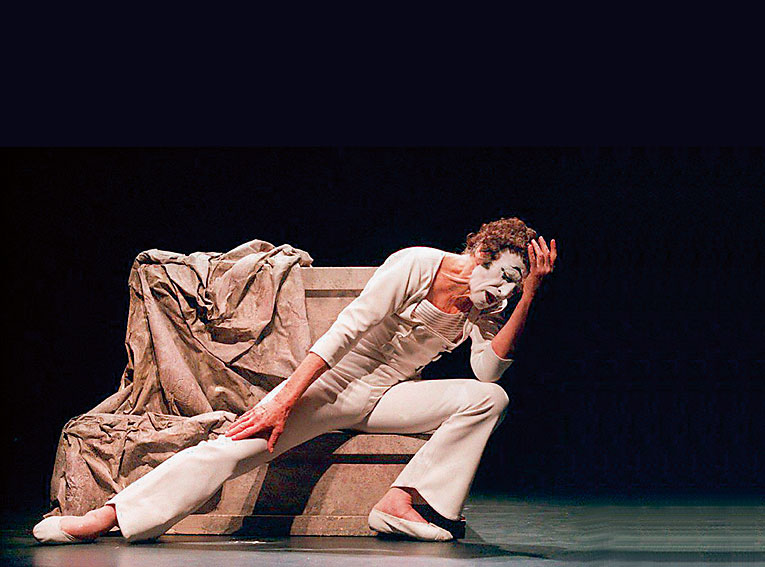
Un vrai fourre-tout. Promotion de carrière, développement personnel, acquisition de compétences managériales, sortie de crise, formation personnalisée. Derrière le vocable très «bling-bling» du coaching se cache une variété très disparate de pratiques et de méthodes. A tel point que les DRH sont souvent déboussolés quand ils reçoivent des offres de coachs certifiés sur leur bureau. De qui s’agit-il vraiment? Qu’est-ce qu’il ou elle sera en mesure d’apporter à mon entreprise? Et comment mesurer l’efficacité de cet accompagnement souvent chèrement payé? Pour répondre à ces questions, HR Today a enquêté sur le milieu du coaching en Suisse romande. Le premier constat est lié à la nature du marché. Selon nos estimations, plus de deux cents coachs sont actifs en Suisse romande. La section «Suisse» de l’International Coaching Federation (ICF) compte environ 140 affiliés. La Société romande de coaching (SR Coach) dénombre une cinquantaine de membres. Et un nombre important de sociétés de consulting propose également un service de coaching dans leurs programmes. En revanche, nos recherches montrent qu’il existe finalement très peu de coachs qui vivent exclusivement de leur métier. Malgré l’absence d’études statistiques sur ce sujet, on les estime à une dizaine seulement. Alors qui sont ces coachs et comment définir leur action? Le coaching ou accompagnement est une pratique assez ancienne, arrivée sur le chevet des managers par le biais du monde sportif. La forte médiatisation des coachs français Yannick Noah (tennis) et Aymé Jacquet (football), illustre bien cet enracinnement progressif du coaching dans les mentalités européennes. Dans les organisations, c’est au tournant des années 1980 que les premiers coachs professionnels ont fait surface en Amérique du Nord. Le phénomène est rapidement importé en Europe, avec un très fort développement des approches psychologiques à partir de la décennie 1990.
Les collaborateurs se retrouvent dans une situation d’insécurité
La plupart des chercheurs universitaires qui se sont penchés sur ce phénomène expliquent l’émergence du coaching par l’importance croissante de l’individu dans les sociétés contemporaines. Dans l’entreprise, cette lame de fond se traduit par l’individualisation des rémunérations, des fixations d’objectifs, des évaluations annuelles et de la gestion des compétences. En corollaire, les collaborateurs se retrouvent dans une situation de fragilité, sous le poids de responsabilités individuelles accrues et d’une insécurité générale liée à leur avenir professionnel. Cette fragilité des individus est accompagnée d’une psychologisation des comportements. D’où l’explosion des approches thérapeutiques du coaching depuis une vingtaine d’années. Mais c’est bien là que tout se complique. Car l’objectif d’une intervention d’un coach en entreprise est chargé d’ambivalence. Est-il sensé venir en aide à un individu, avec toute la complexité humaine et psychologique que cela implique? Ou est-il plutôt au service d’une entreprise, qui lui fixe des objectifs organisationnels à atteindre au travers d’un accompagnement personnalisé? On touche ici à une première ligne de fracture dans la définition du coaching. Et il faut d’emblée clairement séparer le «life coaching», qui s’occupe de trajectoires personnelles et privées (work-life balance ou difficultés dans le couple par exemple) du «corporate coaching», qui s’occupe de la vie en organisation, avec l’objectif d’améliorer les performances collectives et individuelles. C’est bien évidemment le «corporate coaching» (business ou executive) qui intéresse les DRH. Mais cette distinction, bien qu’utile, ne suffit pas à dissiper les malaises. Car à l’intérieur du segment «corporate coaching», on assiste à un foisonnement de méthodes. Pour faire simple, on distingue l’approche thérapeutique, qui renvoie le coaché dans son historique de vie pour comprendre les causes de son action et de ses comportements. Et tente de lui donner les clés de lecture pour qu’il puisse trouver lui-même les solutions au problème.
Dresser un bilan de la situation et fixer des objectifs précis à atteindre
De l’autre, l’approche fonctionnaliste part de l’instant présent pour dresser un bilan de la situation et fixer des objectifs précis à atteindre, souvent d’un commun accord avec l’entreprise mandataire. Mais si la frontière entre thérapeutes et fonctionnalistes est assez claire sur le papier, elle devient nébuleuse dans la pratique. La raison est assez simple. Comme on assiste à un foisonnement des offres de coaching sur le marché suisse romand, et donc à une forte concurrence entre les différents prestataires, les messages sont souvent brouillés afin de ratisser au plus large. Un coach formé en Hypnose Eriksonnienne hésitera souvent à dévoiler ses bases théoriques au moment de faire une offre d’emploi. Il préfèrera recadrer son profil sur celui des entreprises, qui se méfient des débordements possibles dans la vie privée de leurs collaborateurs. «Le marché du coaching en Suisse romande est une foire d’empoigne. Chacun militant pour son école. Avec parfois de grandes contradictions entre les discours et les pratiques réelles», note Alain-Max Guénette, professeur en ressources humaines et en organisation à la HEG Arc à Neuchâtel. Mais cette hétérogénéité de l’offre peut également être positive, estime la chercheuse française Pauline Fatien: «Cela permet à chacun de trouver ce qui lui convient. Le coaching ne sert pas uniquement aux entreprises. C’est une réponse à des aspirations souvent partagées.» Selon la chercheuse, qui termine actuellement un doctorat sur le coaching à HEC entre son style et les besoins du client. J’ai par exemple la réputation de parfois provoquer le client. Mais ce qui est bon pour un client ne l’est pas forcément pour un autre. Il faut donc savoir reconnaître ses limites. Paris, la peur des DRH d’entrer dans la vie privée de leurs collaborateurs n’est pas exempte de mauvaise foi. «Ils occultent une certaine vision du collaborateur qui est avant tout un être humain: quand il vient au travail, il demeure entier. Cela dit, s’il n’est pas souhaitable de réduire une personne à sa dimension fonctionnelle, le coaching n’est pas non plus une thérapie», précise-t-elle.
Comment opérer un tri parmi la pléthore de coachs dits «certifiés»?
Sans entrer dans le détail des approches thérapeutiques et fonctionnalistes, il existe bien une ambivalence entre l’offre des coachs de Suisse romande et la demande des managers. Sachant qu’une erreur de casting risque de coûter cher à l’entreprise (et au DRH qui a donné son accord), comment faire son choix? Un bon moyen d’opérer un tri parmi la pléthore de coachs sur le marché est de passer par les associations faîtières. L’ICF propose un questionnaire détaillé pour aider les DRH à cibler leur recherche (www.coachfederation.ch). D’autres associations proposent des listes de coachs selon leurs spécialisations et des conseils pour faire le tri. Parmi eux, la European Coaching Federation (www.eucf.org) ou la Société romande de coaching (www.srcoach.ch). Un autre indicateur intéressant est celui de la formation. Là encore, les écoles qui prétendent offrir des formations en coaching sont nombreuses. Et il faut donc se méfier des coachs dits «certifiés». Grande spécialiste du coaching en Suisse romande et créatrice de IDC Institut de Coaching à Genève (www.idc-coaching.com), Hélène Aubry Denton précise: «Le coaching est un vrai métier qui ne s’acquiert qu’en le pratiquant. Je conseille les formations avec une systématique dans l’apprentissage des compétences. Les bons processus de formation alternent des formations théoriques en présentiel avec des périodes de mise en pratique sur le terrain. Le coach en formation doit être supervisé à chaque étape. Chez nous, ce processus dure quinze mois en tout». En Suisse romande, HR Today a recensé une demi-douzaine d’écoles réputées pour leur sérieux. Il en existe évidemment beaucoup plus et il y a plusieurs cursus possibles pour celui qui désire s’établir comme coach en Suisse romande. Citons cependant l’IDC Institut de Coaching de Genève; l’International Coaching Institute; Mosaïque Systémique (France) et Solutionsurfers (Suisse alémanique). Il faut également mentionner les deux ténors américains Newfield Network et CTI (The Coaches Training Institute).
«Un bon coach comprend ce qu’est le stress et les jeux de pouvoir»
Si la qualité de la formation est un indicateur important, le bagage professionnel du coach est également décisif. Hélène Aubry Denton assure qu’une expérience en entreprise est indispensable: «Il ne s’agit pas de compétences techniques spécifiques. Mais plutôt d’avoir un vécu du monde des organisations. Comprendre ce qu’est le stress professionnel, les luttes de pouvoir ou la pression des délais.» Enfin, à l’heure des possibilités de recherche illimitées offertes par Internet, le bouche-à-oreille demeure toujours aussi efficace. La Suisse romande est un petit pays et les noms de coachs «performants» font rapidement le tour des cafétérias. Prendre soin de son carnet d’adresses est donc un excellent moyen pour se prémunir d’un couac lors d’un processus de «coach-casting».
Pour aller plus loin: Sébastien Gand et Jean-Claude Sardas, L’émergence de nouvelles pratiques d’accompagnement personnalisé: positionnement, enjeux et diversité des pratiques de coaching, in Sardas J.-C., D. Giauque et A.M. Guénette (dir.): Comprendre et organiser: quels apports des sciences humaines et sociales?, Paris, L’Harmattan, 2007, 550
L'intervenante
 Hélène Aibry Denton est la créatrice et directrice de IDC Institut de coaching de Genève.
Hélène Aibry Denton est la créatrice et directrice de IDC Institut de coaching de Genève.

