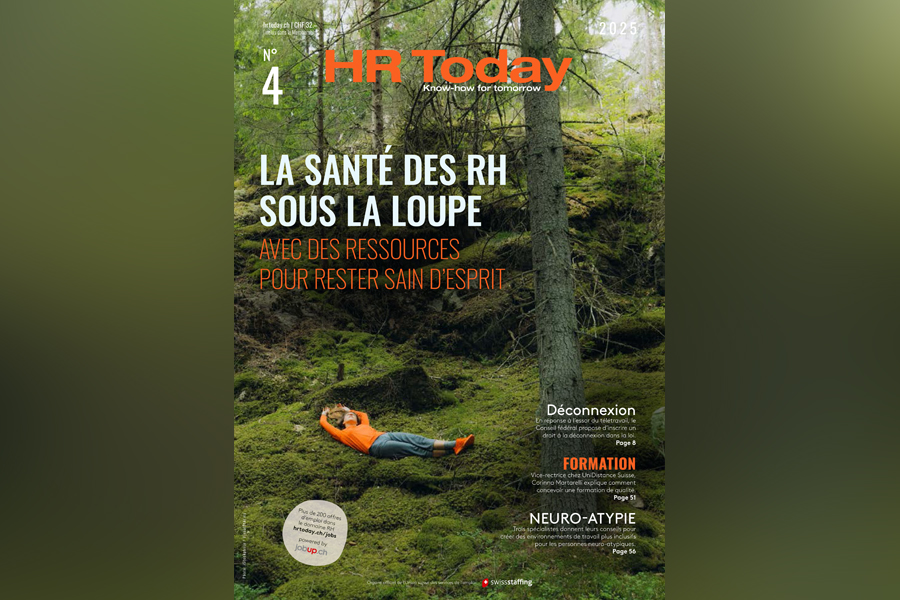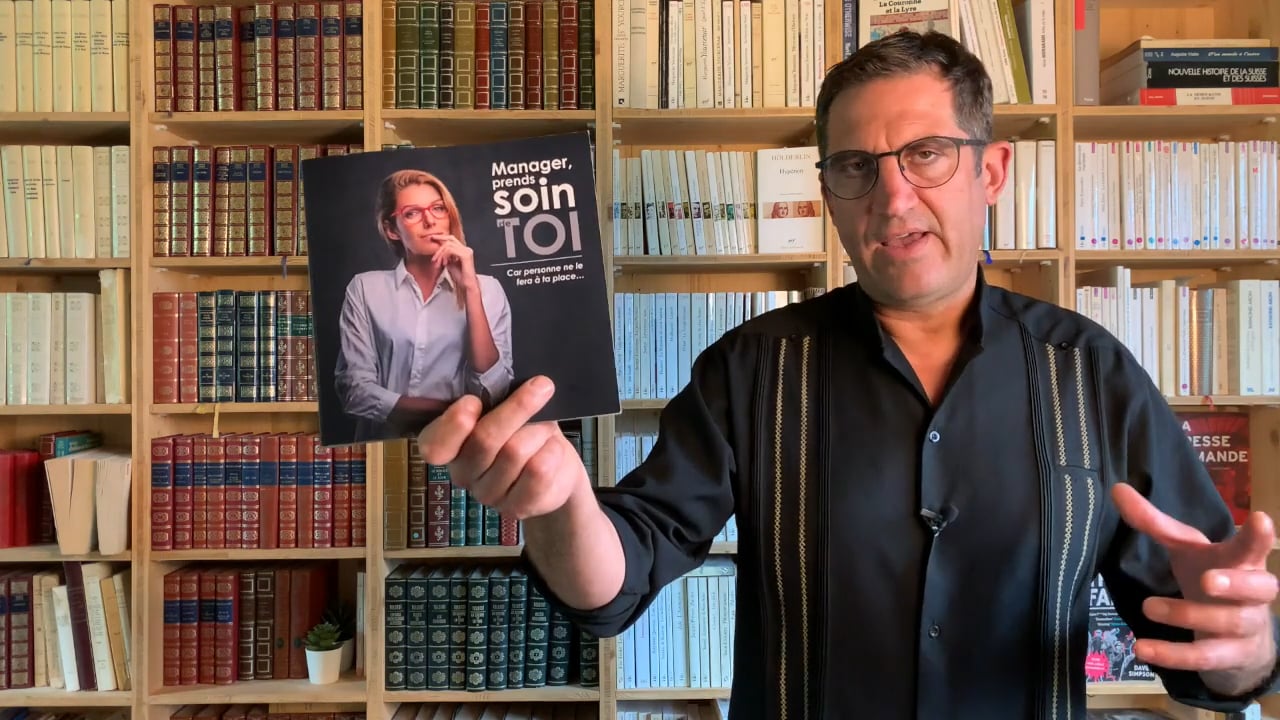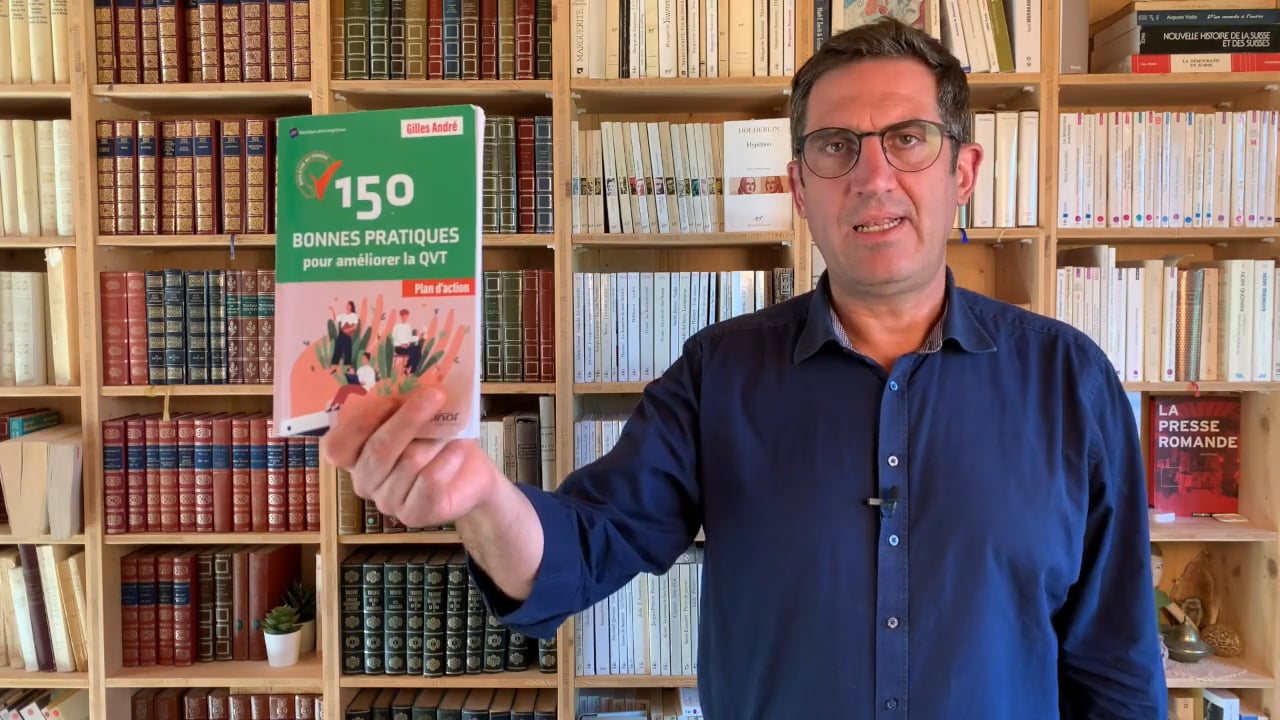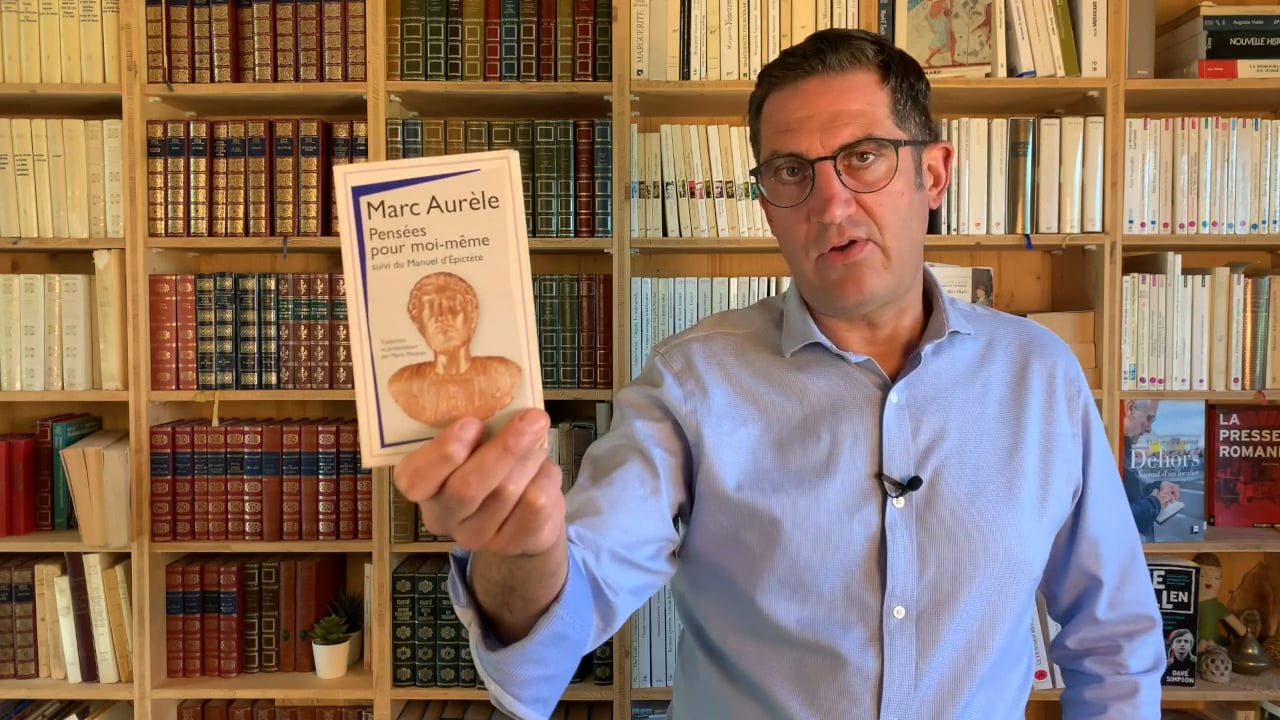La santé des managers RH se détériore depuis la pandémie
Isolés et confrontés à des situations humaines de plus en plus complexes, les professionnels RH paient de leur santé. Deux spécialistes donnent leurs conseils pour tenir le coup dans un monde du travail qui se durcit.

Photo: iStock
Leur mission est de prendre soin du personnel, mais personne ne prend soin d’eux. Les professionnels RH sont les cordonniers les plus mal chaussés de la santé au travail. Au Royaume-Uni, 52% des managers RH ont souffert de burnout depuis l’an 2000, selon une enquête de Personio (solutions RH) publiée en janvier 2025. Et ils seraient 34% à vouloir quitter la profession à cause du surmenage. Il manque encore des statistiques pour la Suisse, mais on sait que 30% des employés du pays sont épuisés émotionnellement (selon le Job Stress Index de 2022). La pression sur la santé des RH augmente depuis la pandémie de 2020, indique une étude de Gartner (conseils tech) publiée en 2023. Sur les 217 professionnels RH sondés, à peine 10% assuraient pouvoir exécuter leur job de manière optimale. Et 55% affirment que la complexité des situations qu’ils doivent gérer augmente.
Des problèmes complexes
Isolée, mal perçue et souvent mal comprise, la fonction RH tient une position d’équilibriste entre la direction générale et l’ensemble du personnel. Le devoir de confidentialité exigé par la fonction renforce leur solitude. Les RH doivent aussi gérer des problèmes humains de plus en plus complexes: surcharge de travail dans un contexte économique tendu, des cas de harcèlement, des personnalités toxiques, des conflits ou des jeux de pouvoir. Des interventions souvent effectuées dans l’urgence quand les cadres sont dépassés par les événements, faute de temps et de savoir-faire.
Piliers de l’organisation
Selon Caroline Corvasce, responsable de la formation chez Incendiz en France (groupe spécialisé dans le risque incendie) et auteure d’un livre sur la santé des managers (voir la référence ci-contre), les RH doivent être les piliers de l’organisation. «Considérés comme des relais entre employeur et employé, les RH sont tournés vers les équipes plutôt que sur eux-mêmes. Passionnés par l’humain et par leur métier, ils ont parfois de la peine à garder une distance saine avec leur travail.»
Signaux d’alerte
«La prise de conscience est parfois lente. L’état d’épuisement peut durer pendant des années avant qu’une crise ne se déclenche. Les signaux d’alerte peuvent être de l’irritabilité, de la difficulté à se concentrer, des décisions impulsives ou une mauvaise qualité de sommeil. Très souvent, votre entourage le remarque avant vous», poursuit Caroline Corvasce. Il faut donc commencer par accepter ses limites.
Savoir dire non
Auteur d’un livre sur le bien-être au travail et aujourd’hui directeur de projets chez AirZen Radio en France, Gilles André abonde: «Malheureusement, quand les RH réalisent qu’ils sont en surmenage, c’est souvent trop tard. Savoir se fixer des limites est clé. Steve Jobs disait par exemple que décider de ne pas entreprendre quelque chose est parfois plus important que de s’engager sur un projet. Parfois, il faut savoir dire non.»
Plaisir et énergie
Le premier défi pour un RH est donc de prioriser sa propre santé. «Tout comme les consignes de sécurité dans un avion, il faut d’abord ajuster son masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres», illustre Gilles André. Il conseille aussi d’identifier les tâches qui vous apportent du plaisir et de l’énergie. «Les entreprises qui préservent la santé de leurs employés auront tendance à adapter les fiches de poste aux talents des collaborateurs et non l’inverse. Pareil pour un manager RH, il doit identifier ce qui est important et éliminer le superflu.»
But lié au bien commun
Dans un classique de la pensée philosophique, l’empereur romain Marc Aurèle (voir la référence ci-dessous) disait la même chose il y a 2000 ans. Inspiré des penseurs de l’Antiquité, Marc Aurèle conseille d’identifier un but lié au bien commun et de s’affranchir de tout le reste: les plaisirs futiles, les angoisses, les appréhensions et l’opinion des autres. Caroline Corvasce: «Commencez avec vous-même et par effet miroir, vous allez influencer le collectif et changer l’organisation pour mieux vivre en entreprise, de manière plus alignée avec vos valeurs professionnelles tout en faisant profiter le collectif et l’organisation de cette dynamique positive.» En s’appuyant sur les théories de l’apprentissage, elle montre comment un manager RH doit d’abord se familiariser avec le fonctionnement de son propre cerveau. «Il s’agit de comprendre d’où vient la pression. Quelles sont vos croyances? Quelle est votre idée d’un manager RH qui réussit?»
Apprendre à se connaître
Prendre ce temps d’introspection sur nos schémas de pensée et nos croyances permet de mieux se connaître et de briser certains automatismes. L’être humain a plus de 150 facultés intellectuelles différentes. Caroline Corvasce retient la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner (1983) qui en dénombre huit: l’intelligence verba-linguistique, visuelle-spatiale, interpersonnelle, corporelle, intrapersonnelle, logico-mathématique, du naturaliste et musicale-rythmique. Connaître son mode de fonctionnement cérébral facilite ensuite les prises de décision et l’ajustement permanent qu’il faut opérer entre ses propres besoins et ceux de l’organisation. «Si tu ne prends pas le temps pour prendre soin de toi, tu prendras du temps pour te soigner!» écrit-elle.
Apprentissage collectif
Le deuxième niveau est l’apprentissage collectif. Connaître son propre mode de raisonnement permet d’identifier les différents types d’intelligence dans une équipe et de rendre les relations plus fluides. Gilles André conseille d’adapter l’organisation aux talents de chacun. Il explique: «Le rôle du RH est de mettre la bonne personne au bon endroit». Les sociologues du travail Crozier et Friedberg ont montré dans leur livre célèbre de 1977 («L’acteur et le système») comment les changements organisationnels peuvent parfois venir de la base. Le processus est le suivant: une personne propose une nouvelle manière de faire (variation). Les autres s’en inspirent et essaient (sélection). La nouvelle manière de faire est adoptée par l’organisation (rétention).
Ingrédients du bien-être
Si les théories de l’apprentissage permettent de modifier l’organisation du travail, il existe aussi des dizaines de bonnes pratiques pour soigner le bien-être au travail. Gilles André: «Le bien-être au travail s’inspire de la médecine chinoise, ce sont des pratiques qui servent à prévenir les burn-out ou les maladies professionnelles lourdes.» Cette tendance, qui vient des États-Unis et des pays scandinaves, est une manière de miser sur le positif et de tout mettre en oeuvre pour que les travailleurs se sentent bien dans leur activité.
Humour, sport et déconnexion
«Il n’y a pas de recettes magiques. Chaque entreprise devra trouver ses propres solutions». Gilles André conseille de com mencer par un diagnostic, de demander aux collaborateurs quels sont leurs besoins en termes de bien-être. Ensuite, choisir des actions, communiquer et enfin ancrer ces nouvelles pratiques dans la culture. Parmi les 150 bonnes pratiques, qu’il énumère dans son livre: l’humour, la pratique sportive, exprimer sa météo intérieure en début de séance, faire des pauses régulièrement (17 minutes de pause pour 52 minutes de travail), autoriser les émotions, se former, clarifier une vision partagée et encourager les moments de déconnexion.
Vivre le moment présent
Enfin, Marc Aurèle conseille de ne pas se disperser ou de se préoccuper des choses inutiles. Son petit livre est aussi une invitation à vivre le moment présent. «Le passé est derrière nous et le futur encore incertain. Inutile de s’en soucier», écrit-il. Se comparer aux autres ou désirer ce que nous n’avons pas est également une impasse. La vraie paix est intérieure, assure le philosophe.