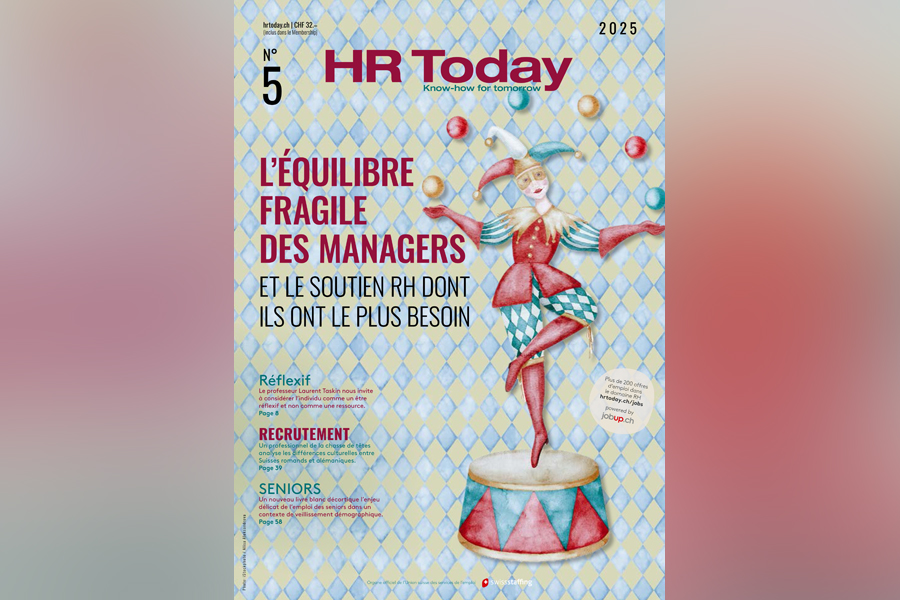«Le management humain se construit en réaction à un trop plein d'individualisme»
Invité au Rezonance Day 2025 à l’Arboretum d’Aubonne, Laurent Taskin, professeur à l'Université de Louvain, a expliqué les quatre piliers du management humain: considérer l'être humain comme un être réflexif, la reconnaissance plutôt que la motivation, le travail réel comme objet central et réinvestir les collectifs de travail.

Photo: Pierre-Yves Massot / realeyes.ch pour HR Today
Votre livre* met le doigt sur l’impasse des méthodes de gestion RH actuelles. Comment résumer ce malaise?
Laurent Taskin: Il s’explique à mon avis par la tentative de légitimation de l’action RH par des outils de mesure et des techniques de reporting. En optant pour cette gestion par les indicateurs, les RH et les managers se sont écartés du travail réel.
D’autres explications?
L’autre malaise vient de l’hyper-individualisation des pratique de GRH. Ces deux phénomènes sont d’ailleurs concomitants. En mettant en place tous ces indicateurs, le cœur de la GRH est devenu l’individu. D’une approche gestionnaire et organisationnelle, elle est devenue psychologique. L’attention est désormais portée sur l’individu – et non plus le travail ou l’organisation comme communauté, ses ressentis, son bien-être avec un tas de pratiques individualisées: les rémunérations, les temps de travail, les parcours professionnels... Cette promesse de tout concentrer sur l’individu et son bien-être contribue à rendre notre rapport au travail plus instrumental. En parallèle, le cadre collectif dans lequel ces rapports individualisés devraient s’inscrire s’est effacé.
Le sociologue du travail François Dupuy a montré que cette exigence d’autonomie des individus date des années 1970 quand ils ont rejeté le modèle tayloriste. L’entreprise leur a accordé cette autonomie mais en échange, elle a imposé un carcan de mesures qui est devenu une nouvelle forme de bureaucratisation. D’accord avec cette analyse?
Oui. Je suis assez proche des analyses de François Dupuy. Sauf que, dans les années 1970, le collectif allait de soi. Le droit du travail et les règles autour du travail étaient assez clairs. Nous étions dans un régime communautaire. L’autonomie n’était pas pensée en termes d’individualisation. Elle visait à réaliser un projet commun. Entre-temps, la vision anthropologique de l’être humain au travail a changé. L’économie néoclassique considère que l’agent économique, le salarié, cherche à maximiser son intérêt personnel. Avec cette vision, le salarié est un calculateur qui risque d’adopter des comportements opportunistes. La bureaucratie dont parle François Dupuy est une réponse à ce risque. Mais de nos jours, les rôles professionnels changent plus vite que les descriptions de fonction. Ce contrôle par la bureaucratie avec la promesse d’un projet commun ne tient plus. Cette vision anthropologique de l’être humain au travail doit évoluer.
Vous avez mandaté des philosophes pour analyser la perception de l’être humain dans les livres de GRH. Quel a été leur constat?
Avant de mener cette réflexion, nous nous sommes rendus compte que beaucoup d’approches critiques de la GRH n’amenaient finalement qu’à mettre des sparadraps sur une jambe de bois: une charte de déconnexion ici, un coach par-là, des managers en formation... Mais tant que vous ne changez pas la carte mère, le changement ne sera pas possible.
Comment décrire cette carte mère à changer?
La réduction de l’être humain à une ressource. Comme expliqué plus haut, cette vision a permis d’accroître la légitimité de la fonction RH depuis les années 70-80. Nous avons donc cherché à questionner cette vision et nous avons demandé en 2018 à un groupe de philosophes de passer en revue les six ouvrages de GRH les plus diffusés dans le monde anglo-saxon et les trois ouvrages les plus lus dans le monde francophone. Ils ont mené une analyse phénoménologique pour identifier quelle était la conception de l’humain dans ces ouvrages. Résultat: ces manuels ne sont pas neutres. Ces livres véhiculent tous la même vision de l’humain, celle d’une ressource qu’il faut exploiter pour produire un résultat économique. L’être humain est une variable économique utilisée pour maximiser la performance de l’entreprise. C’est une vision très réductrice. L’enjeu du management humain est de rassembler tous ces travaux critiques en un endroit, de montrer ce qui est dominant aujourd’hui et de développer des alternatives.
Quelles seraient ces alternatives?
L’approche anthropologique permet de questionner la conception de la personne humaine au travail dans le monde qui est le nôtre aujourd’hui. Nous nous sommes notamment inspirés des travaux du philosophe allemand Axel Honneth qui considère la personne comme un être réflexif, donc acteur de l’organisation. Cela donne de la cohérence à toute transformation du management des organisations.
Vous proposez donc de considérer l’être humain comme un être réflexif. Avec quelles conséquences concrètes en termes de GRH?
Prenons l’exemple des entretiens d’évaluation. Les RH ont développé énormément d’outils pour ces évaluations: des métriques, des formulaires, des dispositifs de feedback en continu, des applications mobiles. Mais qui a développé tous ces outils? Si vous considérez l’être humain comme une ressource, vous faites un benchmark, vous demandez conseil à un consultant, vous développez un outil que vous allez ensuite présenter lors de workshops afin que managers et collaborateurs se l’approprient. À l’inverse, si vous adoptez une conception réflexive de l’être humain, vous allez réunir les personnes qui seront la cible de vos évaluations autour d’une table pour discuter et définir ensemble ce qu’est un travail bien fait, un management de qualité, un objectif qui fait sens... Cette émulation collective aboutit à un dispositif qui contraint les personnes car elles ont participé à sa conception de manière volontaire. Quand vous faites confiance aux personnes et quand vous demandez leur avis, jusqu'à 60 à 70% d'entre elles peuvent participer à la démarche. Considérer le salarié comme un être réflexif est un signal très positif, c'est un antidote au désengagement, c'est créateur de sens. Dans cette perspective, la compétence RH est d'organiser, d'orches-trer, d'être à l'écoute et de se rapprocher le plus possible du travail réel.
Voyez-vous là un lien avec les nouvelles organisations aux hiérarchies plates?
Le constat de base est le même oui, à savoir que les personnes ne sont pas des ressources, mais des êtres réflexifs, ce qui va donc appeler à des méthodes de management qui encouragent le co-design, le co-développement et la collaboration. Mais dans le management humain, cette dimension co-constructive n’est qu’un élément parmi d’autres. Alors que dans ces organisations alternatives que vous citez, la co-construction est parfois le seul élément. Dans ces cas, la perspective anthropologique n’est pas considérée comme une conception de la personne, mais comme une philosophie de gestion qui est souvent fortement liée à la personnalité du leader. Il s’agit donc plutôt d’une multitude d’expériences singulières alors que le management humain est une méthodologie que toutes les organisations peuvent suivre. Dans cette perspective, la co-construction est un des fondamentaux parmi d’autres.
Quels sont les autres ingrédients du management humain?
Toutes les pratiques de GRH devraient être porteuses de reconnaissance. Un autre fondamental serait que toutes les pratiques de GRH portent sur le travail réel. Enfin, le dernier élément serait que ces pratiques consolident les communautés de travail. Ensemble, ces dimensions produisent une boussole structurante pour avancer. L’un ne va pas sans l’autre.
Parlez-nous de cette reconnaissance. Comment devrait-elle apparaître dans les dispositifs RH?
La reconnaissance aujourd’hui est ce qui contribue le plus au sens du travail, qui est devenu beaucoup plus important dans notre engagement qu’il y a peut-être 10, 20 ou 30 ans. Au-delà de cette question du sens, il y a un tas de pratiques managériales qui doivent être repensées pour qu’elles produisent de la reconnaissance anthropologique, c’est-à-dire la reconnaissance de la personne. Comment vas-tu? Célébrer les années d’ancienneté, les mariages, les anniversaires par exemple… Il y a ensuite la reconnaissance pratique, liée à la manière dont le travail est fait, la qualité, l’effort consenti, le «travail bien fait». Enfin, il y a la reconnaissance du résultat. Les pratiques de GRH se sont essentiellement concentrées sur cette reconnaissance du résultat, les bonus, les parts variables, l’employé du mois, etc. Alors que nous avons listé une centaine de pratiques par rapport à ces trois types de reconnaissance.
Il y a enfin une dimension communautaire. Qu'entendez-vous par là?
La dimension communautaire peut découler des trois autres, car quand vous considérez l'être humain comme un être réflexif, que vous produisez de la reconnaissance et que vous tenez compte du travail réel, vous positionnez l'organisation dans une perspective collective. Mais le management humain est aussi le fruit d'une époque. Il se construit aujourd'hui en réaction à ce que la GRH a surtout engendré comme modèles et théories, trop de leadership et trop d'individualisme. Depuis les trois dernières décennies, les discours de GRH ont fortement tourné autour d'une individualisation de la pratique mais aussi d'une personnification des choses dans l'image du leader. Le management humain vient analyser ces pratiques au regard de leur contribution à la communauté de travail et au bien commun. Il s'agit de re-responsabiliser les organisations.
* Laurent Taskin et Anne Dietrich: Management Humain - éd. De Boeck Supérieur, 2024, 304 pages, élu "meilleur ouvrage de management 2025".