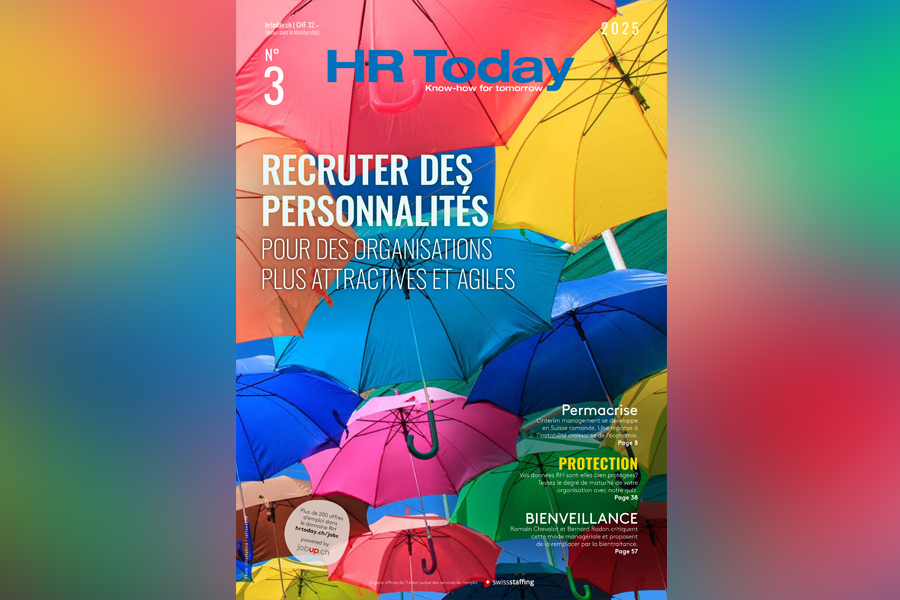Les impacts potentiels de la digitalisation sur la culture organisationnelle
La transformation digitale dépasse largement le simple déploiement d'outils technologiques. Elle a des impacts d'ampleur sur le travail, la manière dont il est effectué et les interactions professionnelles. Par ricochet, il est indéniable qu'elle est amenée à transformer la culture organisationnelle. Mais comment? Et avec quels impacts?

Illustration: iStock
La culture organisationnelle est souvent résumée par l’expression «la manière dont on fait les choses ici» (c’est-à-dire au sein de l’organisation). Bien que difficile à saisir, cette culture constitue le socle identitaire d’une entreprise: elle englobe ses valeurs, ses rituels, ses modes d’interaction ainsi que les croyances partagées par ses membres. Cette définition permet de comprendre la culture organisationnelle comme le fruit d’hypothèses fondamentales et de valeurs collectivement intériorisées qui se traduisent dans les comportements des collaboratrices et collaborateurs. Edgar Schein (référence majeure en la matière) distingue et présente ces trois niveaux comme interreliés: les hypothèses fondamentales (p. ex. la confiance en autrui) influencent les valeurs partagées (p. ex. la collaboration et l’échange permanent), qui à leur tour influencent les artefacts et comportements (p. ex. des espaces partagés et une communication informelle et instantanée). De la même manière, des transformations de comportements et d’artefacts peuvent, sur la durée, transformer les valeurs partagées et à leur tour les hypothèses fondamentales.
Communication digitale, quantification et virtualisation
La digitalisation peut à ce titre représenter des transformations de comportements et d’artefacts, avec des impacts potentiellement profonds sur la culture organisationnelle.
Une première transformation d’ampleur réside dans la généralisation des outils de communication digitale instantanée. L’essor de plateformes telles que Teams, Slack ou Zoom a profondément modifié les modes d’échange en entreprise, en favorisant une communication instantanée, informelle et en temps réel. En matière de culture organisationnelle, le développement et l’adoption de ces outils peut être associé à une évolution de la culture organisationnelle vers l’accélération, l’immédiateté. Cela peut développer une orientation de l’organisation vers le court-terme et des injonctions à l’instantanéité. Cela peut donc entrer en conflit avec des hypothèses fondamentales plutôt orientées vers le long terme et la stabilité. Les anciens repères se brouillent, la «rapidité» devenant une norme implicite, parfois au détriment de la qualité relationnelle ou stratégique.
Une seconde transformation porte sur la quantification croissante du travail, rendue possible par les technologies numériques. En effet, la transformation digitale offre des possibilités accrues de collecte, de traitement et d’analyse des données générées par l’entreprise, les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les clientes et clients. Ce volume de données collectées peut être associé à une évolution de la culture organisationnelle vers les données, leur mesure et leur suivi – dans le meilleur cas, cela peut amener à une culture de la transparence et de la responsabilité, mais cela peut aussi dériver vers une culture du micro-management et de la surveillance. Cela peut ainsi entrer en contradiction avec des hypothèses fondamentales plutôt orientées vers l’instinct, la confiance ou l’exploration.
Une troisième transformation réside dans la virtualisation de l’organisation rendue possible par la digitalisation. Grâce aux outils de communication numérique et l’informatique mobile, de nombreux emplois peuvent désormais s’exercer à distance, de manière asynchrone. Cette dématérialisation du travail modifie en profondeur les repères culturels traditionnels: les interactions informelles, les rituels collectifs, l’exposition aux comportements incarnés disparaissent partiellement, ce qui peut fragiliser le sentiment d’appartenance. Dans le même temps, une culture nouvelle peut émerger, fondée sur la flexibilité, la confiance et l’autonomie. Cette transition soulève des enjeux majeurs: comment recréer du lien sans présence physique? Comment entretenir des rituels à distance? Comment assurer l’intégration culturelle des nouvelles recrues?
Garantir sa culture organisationnelle à l’heure de la digitalisation?
Comme le montre ce rapide tour d’horizon, la digitalisation peut avoir un impact sur la culture organisationnelle. Inversement, certaines cultures organisationnelles sont moins propices à la digitalisation que d’autres (p. ex. dans des organisations traditionnellement plus averses au changement ou dans lesquelles il y a un attachement aux pratiques traditionnelles). Il est donc fondamental pour les organisations d’avoir conscience de l’interaction réciproque entre culture et digitalisation. Cela peut impliquer de capitaliser sur la digitalisation pour transformer sa culture organisationnelle pour l’amener vers davantage de transparence et de responsabilité. À l’inverse, cela peut se traduire par un besoin de protéger la culture organisationnelle pour éviter qu’elle ne dérive vers trop d’instantanéité ou de micro-management, potentiellement par des mesures de déconnexion ou de responsabilisation individuelle. Quoi qu’il en soit, il est fondamental de réaliser que la digitalisation ne s’opère pas en vase clos mais qu’elle est amenée à avoir un impact sur l’organisation dans son ensemble, y compris sur sa culture.