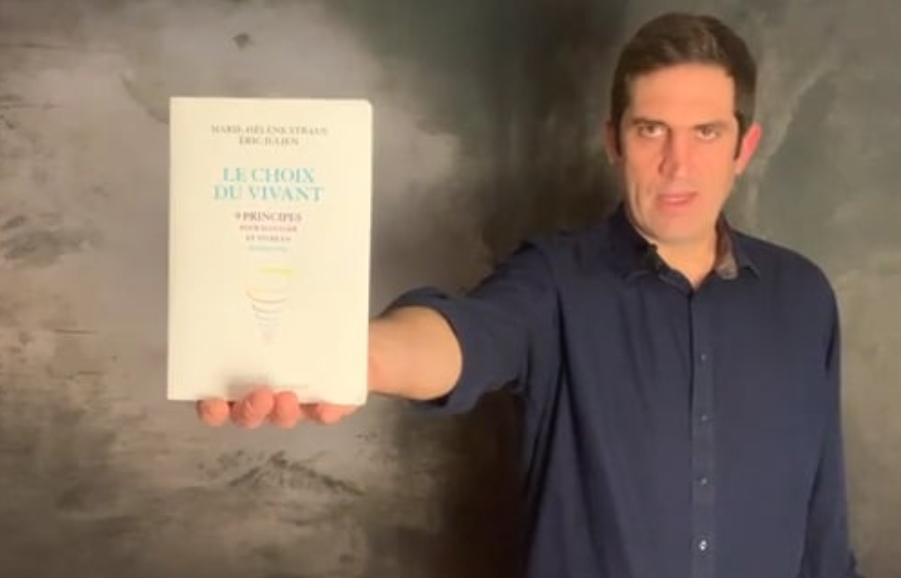«Nous devons accepter d’être confrontés à l’inconnu, au surgissement de la vie»
Co-auteurs du livre «Le choix du vivant», les deux consultants français Marie-Hélène Straus et Eric Julien tissent ici les liens entre la culture des Kogis de Colombie et le management moderne. Ils proposent aussi une issue à l’impasse du capitalisme.

Eric Julien et Marie-Hélène Straus, dans une salle de l'hôtel Ibis près de la gare SNCF de Valence (France), le 22 décembre 2020. Photo: Pierre-Yves Massot / realeyes.ch pour HR Today
Les liens entre les lois de la nature et le management ne sont pas évidents. Donnez-nous un exemple concret où un manager a intérêt à s’inspirer du vivant?
Marie-Hélène Straus: L’exemple le plus évident est la créativité. Léonard de Vinci disait: éloignez-vous et allez dans la nature, vous y trouverez toute votre inspiration. C’est difficile d’être créatif dans une salle en béton. À l’inverse, se reconnecter à la nature, se promener, être dehors et regarder cette vie magnifique qui nous entoure offre un grand nombre de pistes créatives intéressantes.
Eric Julien: L’autre exemple est la réunion. Qui n’a pas vécu ces réunions interminables où l’on se demande ce que l’on y fait? Depuis que l’homme vit sur cette terre, il organise des réunions et pourtant nous avons peu progressé. Pour mettre de l’énergie dans une séance, il faut en manager les polarités. C’est le principe du Ying et du Yang. Une séance a besoin d’altérité, source d’énergie créatrice. Chez les Kogis, cette altérité en réunion se décline sur plusieurs plans. D’abord, ce sont deux personnes différentes qui préparent les réunions. L’une s’occupe du contenu, l’autre de la méthode de travail. Cela fait deux intelligences séparées qui doivent dialoguer entre elles. Ce qui tient à distance les problèmes d’égo ou de pouvoir. Ensuite, comme des poupées russes, il y a un second plan, qui sépare ceux ou celles qui animent la réunion de ceux ou celles qui prennent les décisions. Enfin, un troisième plan identifie ceux ou celles qui participent, et celui ou celle qui observe la réunion, afin de donner un feedback.
Dans votre chapitre sur l’interdépendance, vous écrivez que «la résolution d’un problème est impossible lorsque son évaluation reste subjective, c’est-à-dire perçue différemment par chaque membre d’une équipe». Que voulez-vous dire par là et comment faire pour que cette interdépendance fonctionne?
MHS: Si vous n’êtes pas sur les mêmes niveaux de compréhension, chacun va essayer de régler ce qu’il pense être le problème. C’est ainsi que les malentendus se démultiplient. Il faut donc commencer par se mettre d’accord sur la source du problème, qui est souvent multiple. Cela vous permettra d’aller vers la résolution en partant du même point de départ et en croisant les points «subjectifs» d’observation.
EJ: Un conte soufi du XVIème siècle met en scène un éléphant qui vient devant un village d’aveugles. Des émissaires, aveugles, sont envoyés pour tâter la bête et se faire une idée. Evidemment, chacun revient avec une expérience partielle du réel. C’est pareil en organisation, chacun peut défendre sa perception de la question. Pour moi un éléphant, c’est une oreille... Ou alors, chacun peut s’intéresser à la perception de l’autre. Quand les collaborateurs posent des questions et s’intéressent aux points de vue des autres, le niveau de maturité de l’organisation augmente. Vous entrez dans le dialogue et le partage de représentations. Notre ami fils de charpentier (Jésus, ndlr) le dit dans ses textes: «Demande et on te répondra». C’est à partir du moment où nous ne pensons plus être au centre du monde que commence l’interdépendance.
La question du cadre est aussi très importante. Comment mettez-vous cette question en lien avec l’entreprise libérée?
EJ: Le premier endroit où vous bénéficiez d’un cadre est dans le ventre de votre maman. Pour que l’altérité entre le masculin et le féminin opère, pour déclencher la duplication cellulaire, vous avez besoin d’un cadre. Il s’appelle le placenta. Cette membrane protège, puisqu’elle filtre les informations pathogènes, et laisse passer les bons ingrédients. Pareil dans une structure organisationnelle. Le premier job du manager est de créer un cadre de sécurité. Un endroit où chacun se sent protégé, où la parole peut circuler en confiance avec un filtre. Ce filtre est une garantie qui associe confidentialité et protection.
Et le lien avec l’entreprise libérée?
EJ: Cela peut paraître paradoxal, mais pour être vraiment libérée, il faut mettre beaucoup de cadre. Ce qui n’est pas toujours le cas en entreprise libérée. Cela dit, le principe du cadre se retrouve partout. Dans certains systèmes éducatifs par exemple, le cadre coconstruit avec les enfants leur permet de retrouver de la confiance et de gagner en autonomie. Nous sommes plutôt dans cette logique-là: prendre conscience que le cadre est protecteur et libérateur.
Les penseurs de l’entreprise libérée considèrent l’organisation comme un organisme vivant. En holacratie par exemple, les codes sont très stricts...
MHS: ... mais la vie est très cadrée. C’est le principe d’entropie. Notre univers se dilate. Le grain de café qui se dissout dans une tasse ne se reconstituera jamais. La vie va de la forme à l’informe. Nos corps vont vers la cendre. Sans cadre, tout se dilue. Pareil avec une équipe en entreprise. Sans un cadre précis, la vie ne pourra pas se développer. Cela renvoie à un principe scientifique, l’endosymbiose: deux cellules, quand elles sont protégées par une membrane, peuvent se rapprocher pour coopérer. La coopération n’est possible que dans un cadre.
Sur la créativité, vous dites que nos activités incessantes ne permettent plus les espaces nécessaires pour que puisse émerger la créativité...
MHS: Nous sommes constamment alertés, perturbés, agressés par un monde qui nous inonde d’informations que nous n’avons pas sollicitées. Mais pour que le cerveau soit créatif, il doit s’ennuyer, flotter. Aujourd’hui, rares sont les parents qui laissent leurs enfants s’ennuyer. Ne parlons pas des managers. Ces temps de pause, de paix et de silence sont source de créativité.
EJ: C’est le vide potentiel qui crée la vie. Au début, il n’y a rien. Il faut une intention, une projection et un espace vide mais fécond qui accueille cette intention. Sans espace vide, pas de création possible. «Changez votre rêve et vous irez mieux», nous disent les Kogis. Le rêve est une projection, une intention. Si nous rêvons de violence, elle arrivera. En réalité, nous créons nos propres rêves. Quand nous changeons nos projections et nos rêves, d’autres possibles émergent. Mais pour cela il faut un vide «fécond». Gagner chaque jour un peu plus d’argent et augmenter ses parts de marché est un rêve triste et peu mobilisateur.
Et avec l’accélération du temps, nous avons rarement de vide...
EJ: Oui, avec les rythmes que nous nous imposons, avoir un instant de «vide» paraît presque louche. Certains managers se sentent même coupables. Dès que l’esprit s’arrête deux minutes, c’est l’angoisse. Alors que cette frénésie nous empêche d’écouter le monde. Nous nous sommes coupés du vivant et donc de nous-mêmes. Nous n’écoutons plus le monde, nous ne l’entendons plus, nous ne le voyons plus. La nature est devenue une matière première, un terrain de sport, un espace de loisir ou une esthétique, mais plus une réalité dans laquelle nous aurions notre place, vivant parmi les vivants.
Les nouvelles technologies, les capteurs, les montres connectées et l’IA (intelligence artificielle) nous proposent aussi une alternative à ce silence. Avec l’humain augmenté, la machine sait mieux que l’humain ce qu’il ou elle ressent...
MHS: Oui. L’IA et la machine vont plus vite que le cerveau humain. Nous avons par contre quelque chose que la machine n’aura pas, notre conscience et notre libre arbitre. Il ne faut donc pas rejeter la technologie. Mais plutôt se demander comment et pourquoi l’utiliser? Voilà la vraie question. «Science sans conscience n’est que ruine de l’âme», dit le sage. Est-ce la machine qui me pilote ou moi qui pilote la machine? Quand allons-nous reprendre notre pouvoir de conscience et d’intelligence? L’humain est très intelligent. Par contre que fait-il de cette intelligence, de ce libre arbitre? Les Kogis disent: «Nous pensons avec la tête, puis nous agissons avec nos jambes. Vous, petits frères, vous agissez avec vos jambes puis vous pensez avec la tête». Le moine Matthieu Ricard dit quelque chose de semblable: «L’humain a été capable de créer des machines qui vont plus vite que son cerveau, mais il n’a toujours pas pris le temps de comprendre son cerveau». C’est dommage.
Comment s’en sortir?
MHS: Il ne s’agit pas de rejeter ce qui existe mais de prendre le temps de se comprendre. Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que j’ai apprivoisé, comme disent les Kogis, ce cheval fou qui est en moi? Est-ce que je sais comment fonctionne le vivant en moi, mon corps? Est-ce que je sais accueillir, partager mes émotions, de manière calme et posée? Il y a encore beaucoup de travail afin de mieux se connaître. Ensuite seulement, nous utiliserons la technologie pour aller mieux, pour faire mieux, pour essayer d’aller vers un monde de paix et d’harmonie. C’est un choix. Notre livre s’appelle le choix du vivant, parce que nous pensons qu’à chaque instant de notre vie, nous avons le choix.
EJ: Nous sommes des exilés. Des exilés du vivant et donc des exilés de nous-mêmes et du vivant que nous avons en nous.
Depuis quand?
EJ: De mon point de vue, en France, la date charnière a été la guerre de 14-18. Avant ce conflit, plus de 80% des habitants d’Europe étaient des ruraux, avec un autre rapport à l’espace et au territoire. Aujourd’hui, nous sommes à 85% des urbains. Pour cet entretien par exemple, nous sommes assis-là, dans une salle carrée, climatisée où la texture vivante est absente. C’est en ce sens-là que nous sommes des exilés. Et tout nous attire vers l’extérieur de nous-mêmes. La technologie nourrit avant tout un désir. Un désir de possession, d’exister, de pouvoir et d’agir... La technologie réveille en nous un désir qui nous exile de notre intériorité. «Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les hommes», dit le sage. Mais combien de temps passons-nous effectivement à explorer ce truc bizarre que nous appelons «être humain»?
Comment sortir de l’impasse?
EJ: Je vois six paradigmes à l’œuvre dans nos sociétés modernes. Le premier est de relancer la croissance en investissant des milliards. En d’autres termes: continuons comme avant... Le second est celui auquel sont confrontés les élus écologistes des grandes métropoles en France, comme Bordeaux ou Strasbourg. Quelle est leur marge de manœuvre? Si je résume, ils proposent de faire la même chose mais en plus propre: du bio dans les cantines, des panneaux solaires, des tramways, des espaces verts et un peu de social... Le troisième paradigme est technologique, c’est celui d’Elon Musk. Lui croit en un modèle extraordinaire «technologique» qui va résoudre tous les problèmes. Mais il ne change pas le modèle non plus, au contraire, il le focalise sur la technologie, ce qui pose des problèmes en termes de métaux rares et de matière première. Elon Musk est remarquablement intelligent, mais on a l’impression qu’il est comme un petit garçon fasciné par son train électrique... Ensuite, vous avez un autre paradigme qui est plus récent, c’est celui du «tout va s’écrouler», la collapsologie, qui est en réalité un vieux serpent de mer. Et enfin, cinquième paradigme: la décroissance et la sobriété heureuse portée entre autres par Pierre Rabhi, pareil que la collapsologie mais plus sobre. Parmi ces cinq modèles, aucun ne questionne le modèle dominant, ils n’en sont que des adaptations.
Et le sixième paradigme?
EJ: Accepter de dialoguer avec le vivant, de retrouver notre «place» parmi les vivants. Accepter d’être transformé. Ce qui n’est pas donné à tout le monde. Raison pour laquelle nous insistons sur l’espace de confiance nécessaire pour cela, la matrice et sa dimension éminemment féminine. Dans quel espace vais-je accepter de mourir à une vision du monde pour renaître à autre chose? C’est pour cela que nous proposons un dialogue avec les Kogis. Eux n’ont pas perdu la conscience des principes du vivant. Nous oui. Notre but n’est pas de devenir Kogi, mais d’essayer de réveiller ces principes en nous et dans nos sociétés modernes, territoires, organisations, entreprises. De mourir à un système de représentation obsolète, pour renaître à autre chose, d’accepter d’être confronté à l’inconnu. Par nature, la vie est inconnue et surgissement.
Et dans un premier temps, vous souhaitez intégrer ces principes du vivant en entreprise?
EJ: Le monde managérial est très masculin. Pour le masculin, l’inconnu c’est la non-maîtrise. Et la non-maîtrise fait peur en entreprise. Ce n’est même pas concevable.
Vous restez pourtant optimiste?
EJ: Lorsque l’on se retourne et que l’on regarde l’histoire, quand ces principes du vivant ont été appréhendés et compris, cela a toujours ouvert de grandes périodes de paix et de créativité. À l’inverse, quand ces principes ne sont plus perçus, ce furent des moments de régression et de violence. Paradoxalement, nous vivons aujourd’hui dans un moment de régression. Le géographe français Elisée Reclus (1830-1905, ndlr) parlait déjà de ces périodes de progrès et de regrès liés à la conscience ou non, des principes du vivant. Pensez à l’Andalousie de l’an 1000. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, les orthodoxes y vivaient en paix. Ce fut une époque de tranquillité et de progrès culturels et scientifiques phénoménaux.
Comment retrouver cet équilibre?
EJ: La question clé est la suivante: quels sont les variants et les invariants? Les invariants sont la vie. Elle est arrivée il y a 3 milliards 800 millions d’années, c’est un invariant. Elle s’est démultipliée, déployée, mais elle est là. Les variants sont le contexte culturel, technique, dans lesquels la question se pose. Cro-Magnon n’est pas pareil à l’homme augmenté. Vivre en ville ou à la campagne ne revient pas au même. Il y a donc un dialogue permanent entre une époque et les invariants du vivant. Parfois on y arrive, et parfois pas du tout... Ce qui est certain, c’est que la vie ne va pas nous attendre et n’a pas besoin de nous.
Comment s’appelle ce sixième paradigme?
EJ: Le choix du vivant. Dialoguer avec la vie. L’éco-modernité. Nature Society. Ou comment remettre le vivant, le féminin, au cœur de la modernité sans exclure les atouts de la modernité. Cela veut dire faire des choix, entre l’important, souvent désigné par le verbe «avoir» et l’essentiel, qui parle plus de «l’être». Qu’est-ce qui est le plus important? Pour les Kogis, c’est de vivre en paix et de soigner la terre. Imaginez un peuple qui apprend à vivre en paix à ses enfants et qui apprend de quoi ils dépendent pour vivre en paix. Partager la ressource, partager le commun. Ne plus appeler notre environnement «paysage» mais «pays-sage». Tout d’un coup la nature redevient un sujet. Et nous pouvons dialoguer avec ce sujet.
Pourquoi n’êtes-vous pas écologistes?
MHS: Nous sommes des biophiles. Nous aimons le vivant. Le vrai danger qui guette l’humanité aujourd’hui n’est pas tant la disparition des arbres. Les arbres continueront à pousser. Le vrai danger, c’est le vivant sous la forme d’Homo sapiens. Ce que l’être humain ne comprend pas, c’est qu’en détruisant notre élément de vie, la nature, nous nous détruisons nous-mêmes. Car nous sommes des êtres de nature.
Parlez-nous des liens entre mémoire et culture d’entreprise?
EJ: Un peuple sans mémoire est un peuple mort. Parce qu’il ne sait plus d’où il vient et il ne peut pas savoir où il va. Quand vous demandez à une personne: «Qui es-tu?», il est très rare qu’elle vous réponde, «un être vivant».
MHS: Quand vous accompagnez des humains avec les principes du vivant, le fait de les expérimenter, de les vivre au quotidien, génère une intégration immédiate et naturelle. Parce que cela nous correspond tout simplement. On dit souvent que tout ce qui est juste ne demande pas d’effort. Ces principes du vivant ne demandent pas d’effort parce qu’ils correspondent à notre propre nature. Ils vont constituer une mémoire commune pour l’entreprise, ce qui est source de fertilité.
EJ: Nous ne transmettons rien avec les principes du vivant. Nous les réveillons. Comme une touche de piano qui fait vibrer une corde. La corde est déjà là. Nous essayons simplement de la faire vibrer et d’enlever l’étouffoir pour que les notes sonnent dans toute leur ampleur.
Vous connaissez bien la culture des Kogis, comment perçoivent-ils notre monde du travail?
EJ: La notion de travail telle que nous la concevons n’existe pas chez les Kogis. Quand vous vivez en pleine forêt, comme eux, le travail n’est pas un choix. Ils ne se disent pas: ah, aujourd’hui c’est dimanche, je ne vais pas travailler. Leur calendrier se base sur les étoiles et le cycle des constellations qui guident la vie en général, animale, végétale et humaine. Pour leurs besoins vitaux, les Kogis suivent les étoiles et non la loi des hommes. Si c’est le dimanche à midi que passe un animal, c’est à ce moment-là qu’ils iront le chasser. Leur rapport au «faire» est guidé par un autre calendrier que le nôtre. C’est parce que nous n’avons plus conscience de notre besoin «essentiel» d’être en lien, de nous réaliser comme «être vivant parmi les vivants» que nous avons fait du travail un moyen de pourvoir à nos besoins «d’avoir» et de contrôle. Nous traînons les pieds pour y aller parce que nous n’y voyons plus de sens. Cela génère de la souffrance: mal de dos, problèmes cutanés, tensions, stress, désespérance.
MHS: J’ai demandé aux Kogis leur définition du management en entreprise. Dans un premier temps, ils n’ont pas compris le mot «management». Je leur ai dit: manager, c’est gérer une équipe, emmener des gens sur un projet commun, atteindre des objectifs. Ils m’ont répondu: chez nous, manager se dit «Kuamalde» que l’on pourrait traduire par guérir. Pour les Kogis, le rôle du dirigeant en entreprise est de guérir les relations, à soi, aux autres, à une équipe, au monde, et non pas d’accentuer les tensions, et les déséquilibres.
Donnez-nous trois enseignements Kogis utiles pour un manager en 2021?
MHS: Apprenez à reconnaître et à canaliser votre égo. C’est celui qui vous fait le plus de tort.
EJ: Alignez dix managers contre un mur et choisissez celui qui rigole et qui a de l’humour. Cela veut dire qu’il a un peu de discernement et un peu de recul sur lui-même. Avec lui, il y aura moyen de faire quelque chose.
Et un troisième?
EJ: La lecture des situations, qui nécessite attention et discernement. Quand un dirigeant entre dans une réunion, il doit apprendre à «lire» ce qui s’y passe. Comment les gens sont-ils assis? Quels est leur langage corporel? Leur vocabulaire? Comment travaillent-ils? Où? Posent-ils des questions? Sont-ils ponctuels? Se coupent-ils, elles la parole? Si vous avez une «juste» appréhension d’une situation, vous pourrez prendre des décisions adaptées. C’est ce que l’on attend d’un pilote d’avion ou d’un chirurgien, qu’il ait une juste représentation d’une situation pour prendre de justes décisions? Alors pourquoi en serait-il autrement d’un dirigeant? C’est donc une capacité de danser avec le réel. Un bon dirigeant danse, parce qu’il a lu l’organisation, et sait quel mot prononcer à quel moment, quels actes poser et pourquoi?
MHS: Je rajouterais qu’il ne doit pas avoir peur du surgissement. Si vous êtes calme, si vous avez fait votre travail intérieur, vous n’aurez plus peur. N’ayez pas peur. Nous sommes tellement plus puissants en entreprise quand nous n’avons pas peur. Cela ouvre les voies de l’enthousiasme.