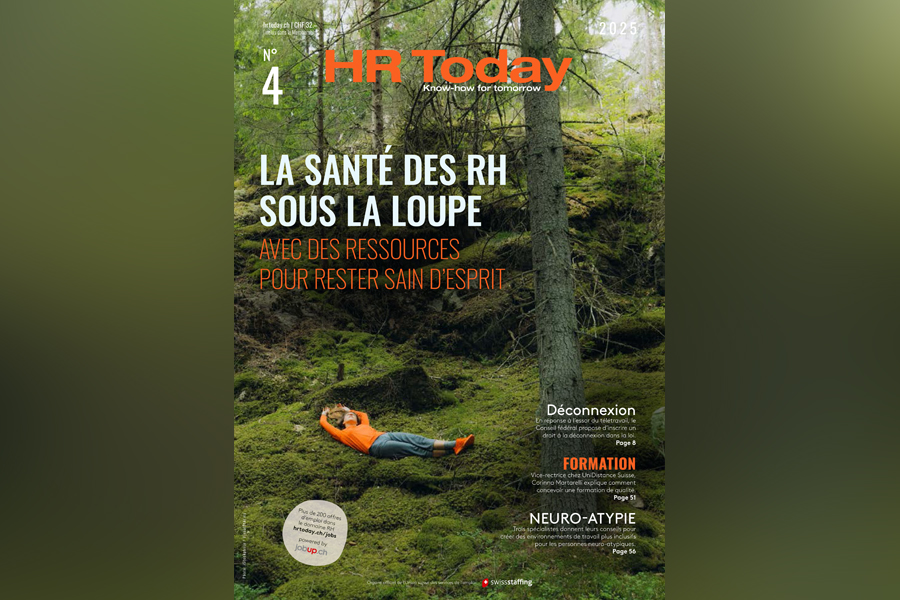People analytics: la fin du flair RH?
L'analytique RH a connu un véritable essor grâce aux avancées en matière de collecte, traitement et analyse des données sur les employés·es. Mais comment mettre en oeuvre des pratiques efficaces et quels sont les facteurs clés à prendre en compte?

Illustration: iStock
Le contrôle de la bonne allocation des ressources représente un enjeu crucial pour les organisations. Avec le temps, celles-ci ont développé des systèmes de contrôle de gestion complexes et élaborés pour s’assurer de l’utilisation efficace et efficiente de leurs ressources. Simultanément, la question de la bonne utilisation des «ressources humaines» s’est posée, avec des enjeux de contrôle et de performance. Face à la difficulté d’obtenir une mesure précise, adéquate et comparable de l’utilisation efficace des RH, l’unité temporelle s’est imposée: l’objec- tif a été de mesurer la présence grâce à des systèmes de pointeuse, badgeuse ou timbreuse. Avec le temps, des méthodes d’évaluation de la performance ont été développées, organisées autour d’indicateurs de performance (plus ou moins directs) et de discussions en lien avec des enjeux de rémunération. Ces méthodes ont souvent été critiquées pour leurs limites, qu’il s’agisse de la véracité de la mesure de la performance ou des questions d’objectivité dans l’évaluation et des biais potentiels des évaluateurs.
Les systèmes d’information se sont quant à eux développés dans les organisations à la fin des années 90, ce qui a permis de collecter des données sur les activités des collaboratrices et collaborateurs d’une manière plus systématique. C’est dans ce contexte que le concept de people analytics a émergé, avec la promesse d’une nouvelle approche de la GRH, fondée sur une analyse quantitative et basée sur les données. Le postulat fondamental est que les organisations disposent d’une mine d’informations objectives qui peuvent être utilisées pour prendre de meilleures décisions. Il peut s’agir d’horaires de connexion ou de badgeage, de jours d’absence et maladie, d’indicateurs suivis de manière régulière, de questionnaires sur le bien-être et la santé au travail. Toutes ces sources de données peuvent être combinées, traitées et analysées de manière objective à des fins organisationnelles et humaines. Adopter une approche people analytics peut permettre d’optimiser le recrutement, l’onboarding, la gestion des carrières ou à peu près n’importe quelle activité RH. En ce sens, le potentiel des people analytics est colossal, tant en matière d’expérience employé·e que de performance organisationnelle.
Prérequis principaux
Développer une stratégie de people analytics et s’engager à utiliser de manière systématique des données pour supporter les décisions managériales et RH implique deux prérequis principaux. D’une part, il est nécessaire de disposer de données de qualité. Cela peut paraître une évidence, mais les implications sont plus larges: dans quelle mesure les informations sur les employés·es et leur activité sont-elles à jour? Est-il possible d’accéder et de consolider les informations potentiellement contenues dans divers systèmes d’information (SIRH, CRM, etc.)?
D’autre part, il est fondamental de disposer des compétences et outils nécessaires à l’analyse. Il s’agit d’abord de compétences de traitement et de préparation des données, ensuite de compétences d’analyse (principalement statistiques) de ces données et enfin de compétences d’interprétation de ces statistiques: comment interpréter ces valeurs et leur significativité? Quelles sont les implications de ces analyses sur les mesures à prendre au niveau individuel, collectif et organisationnel? À l’heure où les algorithmes automatisent une partie des traitements et analyses de données, les compétences techniques peuvent devenir moins centrales. En revanche, développer une rigueur méthodologique et un esprit critique reste essentiel pour comprendre les limites et les implications des prédictions algorithmiques.
Réserves majeures
Alors que les people analytics suscitent un engouement élevé, certaines réserves émergent déjà, pointant certaines limites et dérives potentielles de l’approche. Un des premiers points de réserve porte sur les enjeux de surveillance et de contrôle accru associé aux people analytics. En effet, la mise en œuvre d’une stratégie de people analytics suppose une collecte et un suivi régulier d’indicateurs sur l’activité professionnelle des collaboratrices et collaborateurs. Ce suivi peut être plus ou moins invasif et créer des formes de méfiance de la part des employés·es vis à vis de l’organisation. En outre, cela soulève bien entendu des questions éthiques.
Une autre réserve réside dans les biais potentiels liés aux données et aux algorithmes qui peuvent être amenés à les traiter. Tout d’abord, la question de l’objectivité des données collectées se pose: dans quelle mesure les données collectées sont-elles exactes et transmettent des informations précises sur la personne ainsi que son travail? Puis, celle de l’objectivité des algorithmes: dans quelle mesure est-il possible d’expliquer les évaluations effectuées par des modèles potentiellement opaques? Cela s’inscrit dans une réflexion plus large sur les limites de cette approche basée sur les données qui conduit à une quantification du comportement humain dans les organisations au détriment d’une compréhension plus qualitative.
S’engager dans l’aventure people analytics requiert donc une maturité technologique (pour avoir les infrastructures et outils nécessaires à la collecte, au traitement et à l’analyse des données pertinentes) mais aussi en termes de compétence afin de gérer les infrastructures, manipuler les données, analyser les résultats et les interpréter de manière critique. Par ailleurs, il est essentiel de mener une réflexion approfondie sur l’ambition et la finalité du projet analytique, en veillant à l’aligner avec la stratégie RH et en plaçant l’expérience employé·e au cœur de la démarche. Bien maîtrisées, les people analytics offrent de nombreuses opportunités pour les organisations, notamment pour anticiper les besoins futurs, personnaliser les parcours employés·es et créer des environnements de travail plus adaptés.