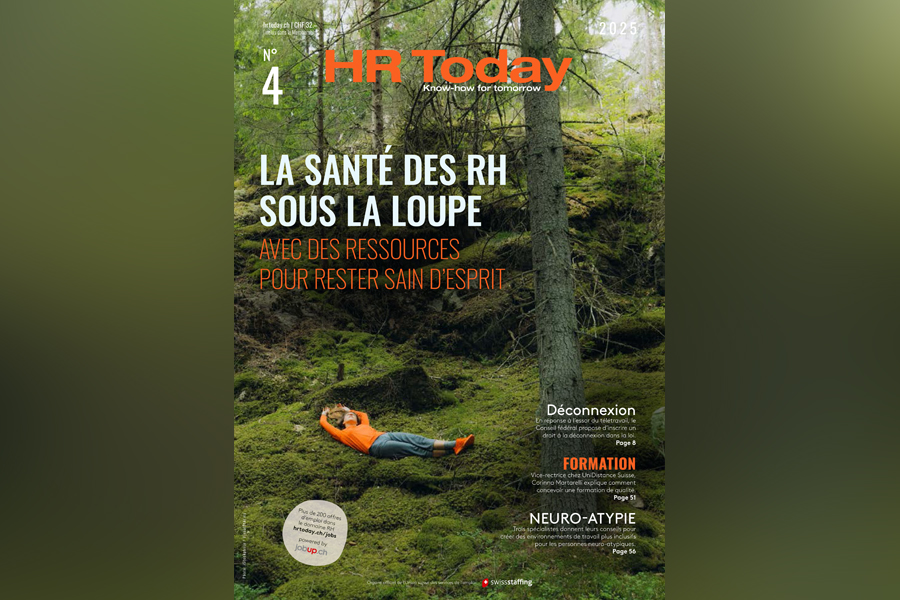«La solitude des managers RH est un vrai problème»
Deux directeurs des ressources humaines, une psychologue du travail et une médecin du travail partagent leurs regards sur la santé des RH en entreprise. Isolés et confrontés à des situations difficiles, les managers RH ne sont pas toujours outillés pour affronter ces défis.

Les intervenants (de gauche à droite): Tamara Ott, Marc Hermant, Catherine Lazor-Blanchet et Mike Pessotto.
Photo: Olivier Vogelsang / disvoir.net pour HR Today
Avez-vous vécu des situations de DRH en détresse?
Marc Hermant: Il y a longtemps, alors que je travaillais dans le secteur humanitaire, j’ai vu des managers RH tellement identifiés à leur mission que toutes leurs émotions s’étaient mélangées. Ils avaient perdu la distance avec leur métier.
Que conseillez-vous dans ces situations?
MH: De prendre du recul et de mettre en place des dispositifs d’accompagnement. Il y a vingt ans, les soutiens psychologiques n’existaient pas et il y avait relativement peu d’aide à disposition. Les choses ont bien évolué depuis. Je constate aussi un changement dans le positionnement des RH. D’un rôle de mise en tension et d’imposeur de règles, ils sont passés à des rôles d’accompagnement de l’humain et de régulation de relations sociales.
Mike Pessotto: Je pratique le métier de DRH depuis plus de vingt ans et j’observe que la fonction est parfois démunie face aux situations qu’elle est sensée régler. La vie en entreprise reflète les évolutions de notre société et les RH sont parfois pris en otage par des situations ou des personnalités toxiques. Face à ces situations difficiles, tout l’arsenal des compétences RH ne suffit parfois pas. Certains cas sont tellement complexes et chargés émotionnellement que le RH n’est simplement pas en mesure de les démêler tout seul.
Comment faire?
MP: J’essaie de recentrer les personnes sur leurs responsabilités, celle du manager RH mais aussi celle du collaborateur qui dysfonctionne. Chacun doit assumer sa part. Le RH ne peut pas tout porter.
Tamara Ott: La détresse des managers RH est souvent invisible ou cachée. C’est donc aussi un travail d’identification émotionnelle à mener. Cette détresse est parfois causée par un manque de sens. Les RH se retrouvent souvent dans des situations kafkaïennes avec beaucoup de tâches administratives à régler sans toujours en comprendre l’utilité. Lors de conflits entre personnes, les RH doivent aussi garder une certaine neutralité et parfois renvoyer les personnes face à leurs responsabilités, qu’il s’agisse d’employés ou de membres de la direction d’ailleurs. Le RH doit rester centré sur lui-même et préserver sa capacité à manœuvrer, en acceptant parfois une part de frustration.
Quels seraient vos conseils?
TO: D’avoir des espaces pour pouvoir ventiler et déposer cette charge émotionnelle, ce stress ou cette incompréhension face à certaines situations absurdes. Le but est aussi de se retrouver entre pairs pour échanger sur des problématiques communes. Ces espaces d’échanges confidentiels se développent en Suisse romande.
Et vous, avez-vous déjà croisé des RH en détresse?
Catherine Lazor-Blanchet: Oui, comme médecin du travail, j’ai déjà reçu des RH en consultation. En général, quand ils arrivent chez moi, c’est que la détresse est déjà bien avancée, avec des répercussions sur leur santé.
Avec quels symptômes?
CLB: Ils peuvent être assez variés: par exemple, des symptômes de stress, des troubles du sommeil, des manifestations anxieuses, voire des symptômes dépressifs.
Quelles sont les causes de ces souffrances?
CLB: Comme d’autres secteurs de l’entreprise, la fonction RH est confrontée aux évolutions et transformations du monde du travail. Face à ces défis, les RH ont le sentiment d’être isolés. Ils souffrent aussi d’un manque de reconnaissance car la fonction est mal comprise. Les RH ont parfois le sentiment d’être pris entre deux feux: ils doivent porter la stratégie institutionnelle tout en comprenant les difficultés rencontrées sur le terrain.
Les RH sont aussi censés prendre soin du personnel en souffrance...
CLB: Oui, mais ces situations individuelles souvent très complexes représentent aussi une grande charge émotionnelle pour les RH. Ces situations sont très diverses: gérer des conflits, des cas de harcèlement, des situations relevant de difficultés sociales, de problèmes médicaux ou psychologiques. Ils ne sont pas forcément outillés pour démêler toutes ces situations et sollicitent parfois le médecin du travail pour des conseils. MH: La solitude des managers RH est un vrai problème. Ils sont sans doute les personnes les plus isolées d’une organisation. En tant que DRH, je montre à mes collègues RH un soutien indéfectible. Mon rôle est de les protéger. Dans ces situations complexes, le rôle des RH est subtil. Ils doivent trouver le bon équilibre et ne pas devenir partie du problème.
Vos managers RH sont-ils parfois critiqués dans ces situations?
MH: Cela peut arriver oui. Et c’est là que je leur réitère ma confiance. Cette confiance du ou de la DRH a un impact très positif.
Quels enseignements les entreprises ont-elles tirés des vagues de suicides au travail qui ont secoué France Telecom en 2010?
MP: Il y a eu une prise conscience que les risques psychosociaux ne sont pas uniquement l’affaire des individus, mais plutôt un problème systémique et collectif. C’est depuis ces événements dramatiques que nous avons commencé à parler de qualité de vie au travail. Le balancier est ensuite peut-être allé un peu loin avec cette idée du bonheur au travail. J’ai un avis assez arrêté sur ce sujet. Ce n’est pas en installant un aquarium et en distribuant des smoothies aux légumes à la cafétéria que nous allons régler les problèmes de souffrance au travail. Cela dit, nous en sommes un peu revenus aujourd’hui.
TO: La prise de conscience est là. Les mesures sont en train d’être mises en place, mais cela va encore prendre du temps.
Quelles sont les mesures à signaler?
TO: Depuis quelques mois, j’anime des formations et des ateliers au sein de l’Université de Genève sur les émotions au travail. Cette intelligence émotionnelle permet d’apprendre à s’écouter, à se réguler par rapport aux autres ou au contexte, de communiquer avec plus d’assertivité et d’éviter la confusion émotionnelle dont vous parliez avant. C’est aussi une manière de diminuer la dissociation entre corps et esprit, qui est une manifestation du burnout.
CLB: L’exemple de France Télécom est emblématique d’une transformation d’entreprise ayant porté gravement atteinte à la santé des employé·es. Les signaux d’alerte à propos des risques psychosociaux étaient déjà là avant 2010.
Et pensez-vous qu’il y a eu une prise de conscience depuis 2010?
CLB: Oui, j’ai l’impression qu’il y a eu beaucoup de remises en question de la part des entreprises. En France, la Cour de Cassation (la plus haute juridiction du système judiciaire français, ndlr) a confirmé en janvier 2025 la responsabilité de cadres et dirigeants de l’entreprise France Telecom et le harcèlement moral institutionnel. La question des suicides au travail est complexe. Dire que ces drames sont causés par la seule fragilité individuelle, qui est l’argument défensif souvent utilisé lors de procédure judicaire, ne suffit pas. Des éléments factuels montrent que des responsabilités se trouvent au sein de l’entreprise.
Quels éléments factuels?
CLB: Pour l’exemple de France Telecom, certaines formes de management et de contrôle des collaborateurs liés aux plans de restructurations menées au pas de charge qui illustrent un management extrêmement brutal et qui causent une perte de sens radicale. Il y a aussi eu des changements de logiques organisationnelles, passant de missions de service public vers un modèle concurrentiel et compétitif.
MH: Personnellement, j’ai toujours travaillé dans des organisations à but non lucratif, où les attentes sont sans doute différentes. Mais je trouve intéressant que ce système français, qui protège beaucoup plus le travailleur que le système très libéral suisse, est un modèle plus brutal quand il s’agit de transformer une organisation. En Suisse, nous pouvons faire et défaire de manière plus fluide, pas par des chemins détournés.
La santé au travail est-elle une question individuelle ou collective, psychologique ou institutionnelle?
TO: C’est un peu tout à la fois. Il faut adopter une approche holistique, c’est justement ce qui manquait jusqu’à présent. Il y a une part individuelle, c’est certain. Mais pas uniquement. Nous parlons désormais de co-responsabilité en entreprise. Et pour l’individu, qui a souvent peu de marge de manœuvre en termes politique et stratégique, la question est plutôt: comment naviguer à l’intérieur de ce système-là?
MH: Comme la formation ou le parcours professionnel, la santé au travail a différents niveaux de responsabilité. Celle de l’institution, qui doit mettre en place un cadre qui protège, qui accompagne et qui donne des opportunités. Il y a la responsabilité managériale, qui accompagne les gens, qui écoute, qui conseille et qui oriente. Et puis il y a la responsabilité individuelle, sa capacité à dire les choses, à prendre de la distance et à se protéger. Tous ces niveaux sont importants.
Parmi les remèdes, les RH cherchent parfois à travailler sur une culture de la coopération conflictuelle, inspirée des travaux d’Yves Clot. Qu’en pensez-vous?
MP: Les dirigeants cherchent à éradiquer le conflit alors qu’il pourrait être considéré comme une ressource pour développer l’entreprise et les équipes. Mais cette vision exige un certain courage. Ce n’est pas facile pour un dirigeant de laisser le conflit s’installer et de permettre à chacun de s’exprimer. Les cultures qui autorisent le droit à l’erreur vont dans ce sens. Cela dit, cette culture du conflit reste encore relativement théorique, à mon avis. Quand une erreur est commise, la première réaction est de chercher le coupable... C’est une manière de se dédouaner et de se protéger. Tout l’enjeu est de s’éloigner de ce syndrome de la culpabilisation pour aller vers la compréhension dans un esprit d’amélioration continue.
MH: Chercher à qui la faute est une manière de personnaliser le conflit. Ce qui est important, c’est de comprendre ce qui s’est passé afin de prendre les mesures pour que cela ne se reproduise plus. Ce climat de confiance est de la responsabilité des managers et de la direction. C’est à eux de créer un climat où les gens ne craignent pas de parler des dysfonctionnements.
CLB: Dans le milieu médical, il existe une culture de la prévention des événements critiques. Dans un hôpital, une erreur médicale peut avoir des conséquences très graves. Ces milieux ont donc développé une culture de l’analyse des causes. Le but n’est pas d’identifier un coupable, mais d’analyser les mécanismes qui ont conduit à un événement indésirable, pour en comprendre la globalité et identifier à quels endroits il faudrait agir pour éviter que cela se reproduise C’est une culture à mettre en place et cela s’apprend.
MP: Plus l’entreprise sera considérée comme un organisme vivant, où tout est interconnecté et où chaque organe a besoin de l’autre pour survivre, plus nous allons nous intéresser aux causes plutôt qu’aux symptômes. Car finalement, le conflit n’est que le symptôme d’un dysfonctionnement plus profond qui met tout le système en déséquilibre. Si vous ne traitez pas les causes, tôt ou tard, le système tombera malade à l’instar de tout organisme vivant.
Quelles sont les formations ou les lectures qui vous ont aidé à tenir votre position?
TO: Personnellement, le livre de Khalil Gibran: «Le prophète». Ce texte m’aide à me recentrer. Il contient un très bon chapitre sur le travail. Gibran pose des questions existentielles. Pourquoi travailler? Au service de qui? Quel est le sens de notre activité? Ce chapitre nous invite à sortir d’une perspective qui réduit la personne à une ressource.
MH: J’essaie d’assister régulièrement à des conférences ou à des séminaires. Et cela arrive qu’un conférencier parle d’une thématique qui me concerne. Ce n’est pas toujours le cas, mais je découvre parfois des idées intéressantes qui me font évoluer.
Un exemple?
MH: Je me souviens d’une conférence de Samuel Bendahan sur le feedback lors d’un Congrès HR Romand à Lausanne. Son intervention m’avait beaucoup interpellé et je l’ai fait venir à Unisanté pour donner une formation à nos managers sur l’importance du feedback. C’est un sujet essentiel. Être capable de dire les choses, particulièrement dans les situations difficiles, est une compétence clé pour un manager.
CLB: Pour ma part, j’essaie de m’intéresser à plusieurs disciplines dans le champ de la santé au travail. J’aime lire ou écouter des anthropologues, des psychologues ou des sociologues par exemple. Cette vision décentrée sur notre pratique est importante. De manière générale, je trouve qu’il manque des ponts entre les disciplines. Ce regard multidisciplinaire est une vraie richesse.
Une lecture récente?
CLB: Le livre de Michel Simonet: «Une rose et un balai», aux éditions Faim de Siècle. L’auteur parle de son amour du métier de balayeur dans les rues de Fribourg. C’est un très beau texte.
MP: Actuellement, je suis plongé dans les neurosciences avec la lecture de Joe Dispenza. J’ai aussi suivi le cursus MAS en développement humain des organisations de la HEIG-VD, avec d’excellentes interventions sur le leadership, le management et le coaching. Cette formation m’a ouvert de nombreuses portes sur le fonctionnement de l’être humain et les vulnérabilités du système de l’entreprise.
Quelles autres ressources externes un·e RH peut-il aller chercher?
MH: Les sections cantonales de l’association professionnelle HR Swiss, surtout quand vous arrivez dans la fonction. Ce sont des occasions pour rencontrer des pairs, échanger et partager des bonnes pratiques. Il y a quelques années, j’ai aussi participé à des repas entre DRH. C’étaient des moments d’échange très riches.
D’autres pistes?
TO: Les cercles de parole entre praticiens. Il y a aussi des services externes, comme le numéro 143 (La Main Tendue, ndlr), qui sont des ressources souvent sous-estimées.
MP: Ces lieux d’échanges entre pairs sont très importants, car ils nous font prendre conscience que nous sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. C’est une manière de démystifier les problèmes. Cela dit, il y a encore sans doute de la retenue de la part des DRH à venir déposer ce qui les préoccupe. Dans le cadre de l’association HR Neuchâtel, nous avons créé un cycle d’intervision où nous proposons à nos membres de venir partager une thématique pendant la pause de midi. Ce dispositif a, pour l’instant, rencontré très peu de succès. Peut-être que les RH n’osent pas encore parler de leurs vulnérabilités. Avouer son incapacité à gérer une situation reste encore assez délicat.
TO: Nous avons fait une expérience similaire à l’Université de Genève, où nous avons proposé des espaces de parole sécurisés et confidentiels. C’est une nouveauté. Pour le moment, ces espaces peinent à être investis. Il est donc important de communiquer et de répéter que les espaces de supervisions, notamment pour les RH, représentent une manière de prendre soin de soi.
Et dans le milieu hospitalier?
CLB: Il peut exister des groupes de parole dans les services, avec des supervisions ou des intervisions. Mais je vous rejoins, je pense qu’il y a encore une difficulté à s’exposer dans une forme de vulnérabilité exprimée ou ressentie, avec la peur d’être jugé. Cela nécessite un cadre bien précis et ce n’est pas donné à tout le monde d’animer ce genre de groupe. Il y a aussi une forte pression à la performance individuelle, de donner la meilleure image de soi.
MH: Absolument. Un directeur général peut s’ouvrir à un DRH et parler de ses difficultés, mais l’inverse serait malvenu. Ce serait annoncer une faille. Donc les RH sont très seuls. C’est pourquoi ces ressources extérieures sont si importantes.
MP: Et peut-être aussi parfois s’offrir un coaching.
Est-ce que des principes éthiques supérieurs aux chartes et aux directives existent-ils dans vos organisations?
MH: Deux fois par an, la direction organise une rencontre avec tous les nouveaux cadres d’Unisanté. Durant ces échanges, j’insiste sur la qualité de la relation et les notions de respect et de bienveillance. La bienveillance s’exprime surtout dans les moments difficiles. C’est facile d’être bienveillant quand tout va bien. C’est plus compliqué quand la relation est tendue ou conflictuelle. Pour moi, la bienveillance, c’est rester en disposition favorable à l’égard de quelqu’un, quelles que soient les circonstances. C’est le message que j’essaie de transmettre.
MP: Nous avons beaucoup travaillé sur les valeurs internes et c’était important pour nous que ces dernières soient définies d’abord par les collaborateurs. Cela a permis d’amener des valeurs comme la qualité relationnelle, la transparence, le courage et l’excellence. Ce travail a permis de décloisonner les départements et de mettre en lumière la difficulté de choisir ou de déchoisir sa propre condition (accepter ou refuser une situation inconfortable, tolérer une personne dysfonctionnelle ou s’en séparer). Communiquer à une personne qu’elle ne continuera pas l’aventure professionnelle est aussi une marque de respect et de transparence pour autant qu’on y mette les formes. En outre, nous avons aussi beaucoup insisté sur l’idée qu’il faut parfois se déconnecter de la tête pour travailler plus avec le cœur, en laissant parler son ressenti et son intuition.
TO: Lors de mes entretiens, je propose de remettre le travail à sa juste place et d’aider les collaborateurs à réévaluer la relation qu’ils ont avec leur job. Certaines personnes ont tendance à se surinvestir dans leur vie professionnelle. Mais ce rapport au travail est en train de changer. Le travail n’est plus considéré comme une fin en soi. C’est devenu un élément parmi d’autres.
CLB: Dans le cadre de la pratique médicale, quatre grands principes éthiques s’appliquent: la bienfaisance, la non-malfaisance, l’autonomie et la justice. Marc Aurèle conseillait d’avoir un but précis lié au bien commun et de s’affranchir de tout le reste. Quels sont vos buts professionnels?
MH: C’est important pour un DRH de savoir où il va. Pour moi, l’enjeu est la qualité de l’environnement de travail, dans le sens de l’attractivité de l’institution. Pour attirer des personnes de qualité, avec les bonnes compétences, j’ai besoin d’un environnement de travail de qualité, qui permet de concilier vie privée et vie professionnelle, qui permet d’évoluer professionnellement, qui permet de se former et qui est respectueux. Voilà ma finalité.
MP: Je pense que nous avons tendance parfois à nous battre un peu contre des moulins. Pour moi, il s’agit donc de déterminer les zones sur lesquelles j’ai un impact et celles où je n’en ai pas.
Quelles seraient ces zones où vous avez un impact?
MP: Peut-être de défendre les seules deux valeurs qui permettent de garder une certaine ligne: la confiance et la vulnérabilité. La confiance en soi et en l’autre. Partir du principe que l’on peut avoir confiance en l’autre au lieu de se méfier de tout le monde apporte une ouverture très différente. Et puis d’être conscient de sa propre vulnérabilité permet paradoxalement de se protéger de soi-même et des autres, qu’ils soient des directeurs ou des collaborateurs. Cela permet de garder une certaine humilité et de préserver sa dignité.
OT: Pour moi, le bien commun se relie aussi au sens. Donner du sens à ce que je suis en train de faire et de vivre.
Et comment définiriez-vous votre sens professionnel?
OT: Je sème des petites graines. J’essaie aussi de ne pas perdre ma curiosité face aux autres, d’amener des nuances, d’ouvrir les perspectives.
Et pour vous?
CLB: Mon principal but serait d’avoir le sentiment d’avoir été utile. À quelqu’un, à une organisation. Avec également une dimension esthétique, dans le sens du beau travail. Une belle consultation est celle où la personne repart mieux que quand elle est arrivée.
Les intervenants
Tamara Ott est psychologue du travail et des organisations, indépendante (tamaraott.ch) et à l’Université de Genève (6310 collaborateurs·trices).
Marc Hermant est DRH d’Unisanté depuis 2015 (1000 collaborateurs·trices).
Catherine Lazor-Blanchet est médecin du travail et médecin cheffe du service de médecine du personnel et d’entreprise du CHUV depuis 2007 (12 600 collaborateurs·trices).
Mike Pessotto est DRH à la Banque cantonale de Neuchâtel depuis 2008 (340 collaborateurs·trices) et président de l’association HR Neuchâtel.