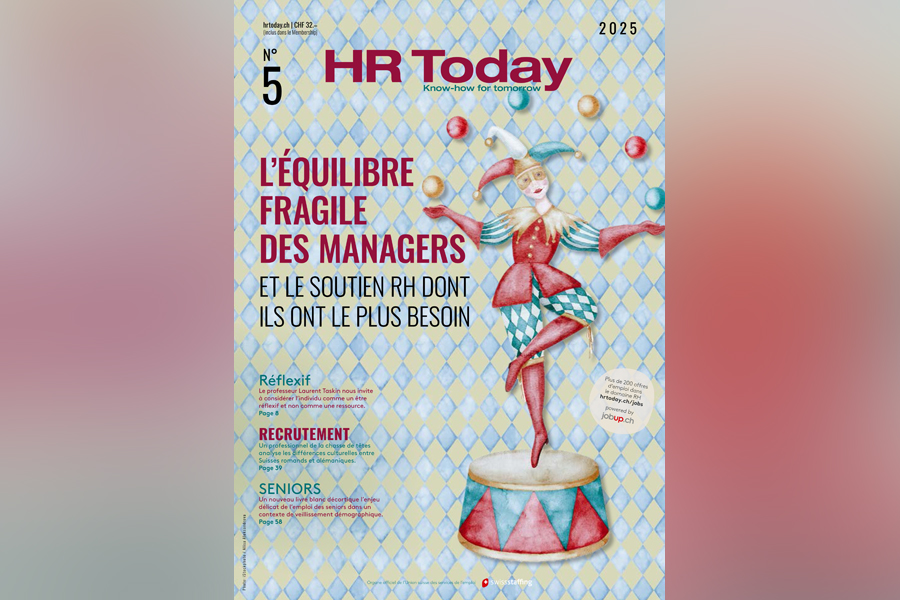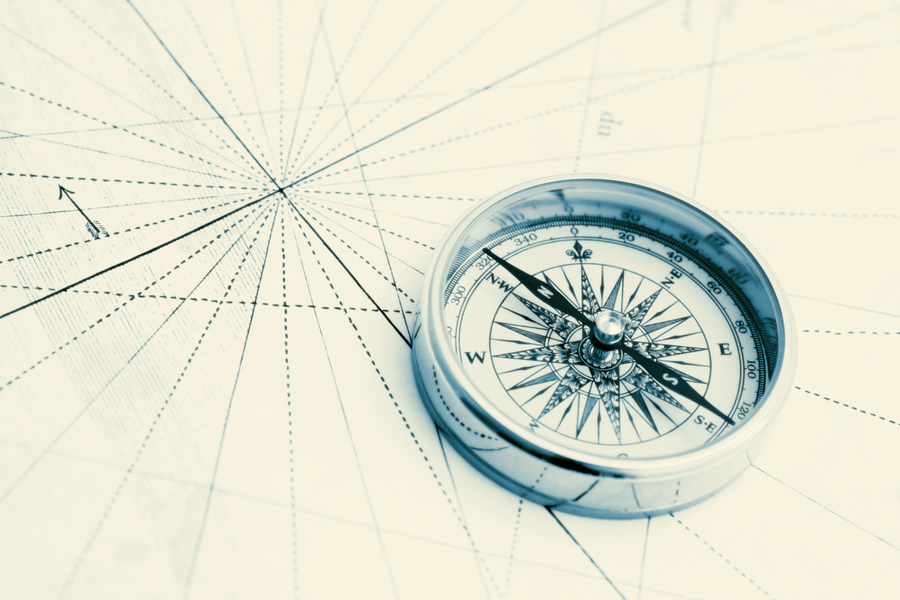«Seuls les RH peuvent apporter ces espaces de lucidité aux managers»
Dans un contexte de plus en plus complexe, les managers se retrouvent isolés et doivent jongler entre leurs responsabilités opérationnelles, une exigence de clarté stratégique et à la multiplicité des demandes de leurs équipes. Quatre experts analysent ici la relation entre RH et managers.

Les intervenants (de gauche à droite):
Carole Haddad est responsable de la filière management et leadership à l’Ifage depuis 2021
Romain Chevalot est consultant et coach de dirigeant
Elsa Berthault est consultante RH chez Axium
Renaud Langel est le fondateur et directeur du groupe Salu
Photo: Olivier Vogelsang / disvoir.net pour HR Today
Quels sont les principaux défis d’un manager aujourd’hui?
Romain Chevalot: Dans mon rôle de DRH, j’ai surtout accompagné des cadres dirigeants. Je distingue plusieurs types de challenges. Il y a d’abord un défi d’ordre géopolitique marqué par l’incertitude et l’imprévisibilité croissante du monde. Jusqu’à présent, le rôle des managers était de probabiliser les scénarios possibles. Aujourd’hui, la donne a changé, avec des ruptures géopolitiques soudaines et l’arrivée d’autocrates qui rebalaient les cartes avec des échéances ultra courtes et imprévisibles, obligeant les managers à s’adapter en permanence.
Un autre défi actuel pour les managers?
RC: Le deuxième défi serait d’ordre plutôt organisationnel. Pour répondre à cette complexité croissante du monde, les organisations se complexifient à leur tour. D’un seul organigramme, nous sommes passés à une multitude d’organigrammes imbriqués les uns avec les autres, à une multitude d’enchevêtrements de lignes de produits et de responsabilités croisées. Dans ce contexte, le manager aura un supérieur direct et deux, voire trois supérieurs transversaux disséminés dans l’organisation, parfois avec des intérêts divergents. Cela complexifie considérablement ses priorités, avec comme conséquence une forme de perte de repères organisationnels.
Un troisième défi?
RC: Le défi culturel. Je parle ici d’une injonction implicite à incarner un management parfait, du style «gendre idéal». Aujourd’hui, chaque collaborateur souhaite configurer son poste à sa façon: télétravail, temps partiel, horaires flexibles, tout en exigeant de son manager un juste équilibre entre vie privée et professionnelle et une attention accrue à la charge mentale. Dans cette offre organisationnelle à la carte, le manager – qui doit aussi délivrer des résultats – hésite à faire preuve d’autorité, à déléguer ou à exiger. À partir de quand l’exercice de l’autorité devient du harcèlement ou du mobbing? C’est ce que je qualifie de perte de repères culturels. Conséquence: les managers aujourd’hui se retrouvent très isolés et ne savent plus vers qui se tourner pour avoir du soutien.
Carole Haddad: Je vous rejoins sur cette transformation profonde du monde professionnel. Dans ce contexte incertain et imprévisible, le rôle du manager a changé. La façon de collaborer et d’exercer le pouvoir s’exprime par ses compétences transversales. Ce sont ces soft skills qui sont désormais au cœur du métier de cadre, et non leur expertise technique.
Elsa Berthault: Je constate aussi que le rôle de manager ne fait plus rêver. Un manager se retrouve en première ligne dans un contexte qui change continuellement. Cela implique une capacité à gérer cette incertitude. Il ou elle doit accepter que le business peut changer tous les 18 mois, avec des effets sur le turnover de son équipe, qu’il faut donc reformer en permanence. Cela implique aussi une forme de résilience. Le rapport au temps change aussi. On oublie souvent qu’un manager doit assumer plusieurs rôles. Diriger une équipe, mais aussi gérer l’opérationnel, le commercial, délivrer des prestations… Leur plus grand défi est donc souvent d’avoir suffisamment de temps pour pouvoir correctement manager leur équipe…
Renaud Langel: Oui, ce rapport au temps est un vrai challenge. En tant que dirigeant de plusieurs PME, j’essaie d’avoir des visions à 30 voire 50 ans, donc assez lointaines, tout en ayant une stratégie à cinq ans et des problèmes opérationnels à régler au quotidien. Jongler entre ces différents horizons temps créé de la tension.
Quels sont vos autres défis majeurs?
RL: Répondre à la multiplicité des attentes. Le spectre de nos profils est très large, allant de jeunes de 18 ans à des personnes qui s’approchent de 80 ans. Dans l’ancien monde, un manager pouvait conduire ses équipes au bâton et à la carotte, avec des promotions ou de l’argent par exemple. Aujourd’hui, nous devons proposer un éventail de choses beaucoup plus large et parfois difficilement palpables: du sens, de l’empathie, de l’écoute, une capacité d’analyse…
EB: De façon très concrète, cet accompagnement RH «à la carte» s’illustre lors des congés spéciaux: mariage, déménagement, naissance ou décès par exemple. Le droit du travail prévoit un certain nombre de jours de congé et nous doublons ou triplons parfois ces congés pour répondre aux besoins des collaborateurs. Ce sont des moments de vie importants et rares. C’est lors de ces événements que l’exemplarité d’un employeur sera mise à l’épreuve. Une prime de 500 francs a très peu d’effet sur le long terme. En revanche, si vous traitez bien un collaborateur dans un moment de vie difficile, il ou elle s’en souviendra longtemps.
CH: Cette solitude des managers est une réalité et c’est triste de constater que ces parcours ne font plus envie. Le World Economic Forum a montré que la première compétence d’un manager est la créativité et l’innovation. Mais vous ne pouvez pas être créatif si vous avez des soucis personnels. Cet accompagnement RH sur mesure est donc essentiel.
Pourquoi est-ce qu’une carrière de manager ne fait plus rêver aujourd’hui?
CH: Il manque peut-être un discours positif sur ces trajectoires de managers, surtout auprès des jeunes générations. Manager une équipe est un rôle extraordinaire, en contact avec le terrain, à trouver des solutions concrètes et en étant au service de son équipe et de son employeur. Le pouvoir et les bonus ne suffisent plus pour donner envie à un jeune de suivre cette voie. Aujourd’hui, un manager doit maîtriser différents styles de leadership, il ou elle doit créer du sens et trouver des solutions innovantes et durables en tenant compte de plusieurs parties prenantes…
Quels sont les sujets où un manager a le plus besoin des RH aujourd’hui?
RC: Au-delà des fonctions régaliennes RH – gestion des salaires, du cadre légal, respect des obligations sociales – la première mission serait d’être le support stratégique du manager. Si l’intention du manager RH est d’être partie prenante de la stratégie et de se mettre à côté du manager, je lui conseillerais d’aider le manager à clarifier sa gouvernance.
C’est-à-dire?
RC: Comment structure-t-il son activité? Comment délègue-t-il les responsabilités? Quels processus et quels indicateurs de suivi a-t-il définis? Et surtout, quelle est la solidité de son équipe? Cela implique aussi de l’amener à réfléchir, à partir de ses défis et enjeux, à l’organisation et aux compétences qui lui permettront d’y répondre efficacement. Il s’agit d’amener cette clarté stratégique dont le manager a besoin et dont seul le RH, puisqu’il est le seul à avoir cette vue globale, peut lui apporter.
Un autre sujet-clé où un RH peut soutenir un manager?
RC: Le deuxième, sans doute perçu comme un peu «old school», serait de redonner aux managers les clés pour exercer une autorité saine. Car aujourd’hui, autorité et pouvoir sont souvent soit ignorés, soit décrédibilisés. Mais l’autorité, quand elle est exercée proprement et avec clarté, donne un cadre et crée de la sécurité psychologique. Elle peut stimuler la prise d’initiatives car le collaborateur connaît clairement les limites dans lesquelles il peut agir.
Un troisième sujet?
RC: Si le RH veut gagner en impact, je dirais qu’il ou elle doit aider le manager à distinguer les dimensions conjoncturelles des dimensions structurelles. Distinguer ce qui relève du bruit de fond, auquel il faut faire attention mais ne pas sur-considérer et ce qui constitue un changement structurel, tel que par exemple un relèvement massif des droits de douane américains – et accompagner le manager dans ses implications concrètes sur l’organisation des équipes et l’adaptation de ses collaborateurs. Cette capacité de discernement du manager lui permettra d’avoir de la lucidité stratégique et de tenir compte du contexte.
D’autres éléments?
EB: J’aimerais revenir sur le premier point: la clarification de la gouvernance du manager. À mon avis, le responsable RH doit en premier lieu créer une relation de confiance avec son manager. S’il ne le fait pas, soulever ces questions de gouvernance peut être très anxiogène et perçu comme intrusif par le manager. Comme nous l’avons dit, un manager manque souvent de temps et doit faire face à de nombreuses demandes. Selon mon expérience, cette confiance se construit avec le temps. En tant que RH, j’essaie d’abord d’être exemplaire sur mes prestations de base: la paie, les dimensions administratives, la formation, les recrutements... et cela va même au-delà: mes valeurs, mes comportements associés, ma propre gouvernance RH. C’est sur ces fondamentaux que je vais ensuite créer une relation avec le manager et commencer à challenger sa gouvernance et sa lucidité stratégique.
Comment percevez-vous votre rôle RH auprès d’un manager?
EB: Mon job est de leur donner tous les outils pour qu’ils puissent travailler correctement. Mais le premier RH reste le manager. Eux sont sur le terrain avec les équipes. Ce sont eux les points de relais entre les différentes parties prenantes de l’organisation.
RC: Vous pointez du doigt un élément absolument essentiel qui est le niveau de maturité des RH dans les organisations. Certains RH se concentrent avant tout sur la gestion des salaires et sur le suivi du cycle de vie des collaborateurs, de l’intégration au départ. Une fois ces activités de base assurées, je constate souvent un plafond de verre. Au-delà de cette frontière imaginaire, je vois trop peu de RH qui commencent à se mettre dans les chaussures de leur manager car pour y parvenir, ils doivent avant tout comprendre le business. Ils doivent développer une lecture plus stratégique et saisir les impacts des changements de contexte – qu’ils soient réglementaires, liés au marché ou issus de révolutions technologiques. À un certain moment, le RH doit dépasser son seul champ de compétences RH afin d’influencer réellement et d’accompagner plus efficacement les managers.
En tant que patron de plusieurs PME, quel est le soutien RH que vous appréciez le plus?
RL: En plus des bases administratives, deux gros sujets me semblent clés. Le premier est tout ce qui touche à la politique de reconnaissance et de rémunération. Comment reconnaître les collaborateurs et leur travail? En termes de rémunération mais aussi en termes d’évolution de carrière? Ces éléments sont essentiels car ils vont structurer la culture d’entreprise. Personnellement, je travaille sur des projets d’entreprise à visées régénératives, qui visent à contribuer au Bien commun et à avoir un impact positif sur le monde. Et cette vision commence par notre culture organisationnelle. Si ces dimensions ne sont pas bien structurées et ancrées, cela devient un terreau fertile à plein de problèmes.
Le deuxième sujet?
RL: Tout ce qui touche au recrutement. Comment identifier et attirer les talents, comment les garder et comment les faire sortir quand cela s’arrêtera, tout en maintenant des bons rapports avec eux.
Sur quels sujets les RH sont-ils en décalage avec les managers?
CH: L’Ifage (Fondation pour la formation des adultes à Genève, ndlr) reçoit près de 10 000 participants par année, ce qui représente environ 500 formateurs. En tant que responsable de filière, je gère beaucoup de projets et je collabore étroitement avec notre responsable RH. Cette relation va dans les deux sens. Un RH doit essayer de se mettre à la place de son manager, mais c’est aussi au manager d’exprimer ses besoins et d’aller chercher de l’aide sur les sujets qu’il ou elle ne maîtrise pas.
Quels sont les sujets où vous êtes en décalage avec votre RH?
CH: Cela peut être sur des projets innovants. Le domaine de la formation évolue très vite et nous sommes toujours en train de revoir nos contenus et notre approche pédagogique. Nous sommes donc en permanence en dehors de notre zone de confort et cela exige beaucoup d’agilité. Cela se reflète ensuite sur notre collaboration avec les RH qui doivent eux aussi faire preuve d’agilité. Ce n’est pas simple car leur rôle est de faire respecter le cadre et les procédures alors que nous leur demandons parfois de s’adapter aux changements en cours dans l’organisation.
Et pour vous, sur quels sujets avez-vous une longueur d’avance sur votre RH?
RL: Le défi est de réconcilier nos temporalités. Mon rôle d’entrepreneur est de voir loin, avec une vision à 10 ans. Les RH sont dans le temps présent, avec des questions opérationnelles à régler dans l’urgence. Ce décalage est encore plus criant aujourd’hui avec l’arrivée de l’IA qui transforme tout, très vite, voire trop vite. Dans cinq ans, 90% des jobs d’aujourd’hui ne seront plus les mêmes. C’est fou! Cinq ans, c’est demain! Cela soulève des questions de management et de RH où tout va trop vite. Nous n’avons même pas le temps de poser les bonnes questions et de rationaliser l’impact que cela aura sur nos équipes.
EB: C’est pour cela que nous essayons de limiter les strates managériales. Nous voulons que ceux qui font le travail soient au plus près des décisions. Ils doivent être partie prenante de la vision et du développement de l’entreprise. Notre mode de gouvernance a beaucoup évolué ces dernières années.
Et quel serait votre principal défi RH dans cette transformation?
EB: Mon souci est de faire monter en maturité les managers sur des sujets stratégiques. Ils doivent être capables de switcher entre leur casquette d’exécutant et leur casquette de stratège. Et un bon exécutant n’est pas forcément un bon stratège, et vice et versa. Tout l’enjeu, avec les organisations plates, est d’avoir des personnes qui ont suffisamment de maturité pour passer de l’un à l’autre. La difficulté aujourd’hui, c’est que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Comment préparer les ambassadeurs et les stratèges de l’organisation à un avenir que nous ne connaissons pas? D’où l’importance de la sécurité psychologique et du droit à l’erreur.
RC: Absolument. Et seuls les RH peuvent apporter ces espaces de lucidité aux managers.
EB: Oui mais c’est difficile de gérer ce décalage entre la vision stratégique et l’opérationnel. Car nous allons demander aux équipes de mettre tout leur cœur dans un projet qui sera peut-être plié dans 12 mois... Dans ce contexte, l’enjeu est de maintenir la confiance, l’énergie positive et la résilience malgré les imprévus et les changements qui vont peut-être tout bouleverser.
Les organisations plates sont-elles mieux adaptées à ces changements permanents et imprévisibles?
EB: La gouvernance distribuée présuppose d’accepter l’incertitude et d’avoir une maturité managériale pour jongler entre les opérations et la stratégie, tout en offrant un cadre suffisamment sécurisant pour que les individus restent motivés à poursuivre l’activité malgré les changements permanents…
RL: Cela va aussi dépendre du secteur d’activité. Si le business est florissant, cette exigence de changement permanent sera beaucoup moins forte.
RC: Nous disons à peu près la même chose même si je ne suis pas forcément un défenseur de ces organisations plates. Je suis plutôt promoteur de la verticalité en matière de leadership. Mais nos interrogations sont similaires. Nous parlons d’agilité, d’espaces de discernement, d’incertitude et de complexité organisationnelle.
CH: Dans le brevet fédéral de conduite d’équipe, il y a un tronc commun de compétences à avoir peu importe le secteur d’activité…
Quelles sont ces compétences de base?
CH: La gestion personnelle, la connaissance de soi, la conduite d’équipe, la gestion des conflits, la communication, la gestion du changement et la gestion RH. Nous constatons que c’est la connaissance de soi qui pose le plus de problèmes. Les cadres en formation ont de la difficulté à réfléchir sur eux-mêmes et porter un regard critique sur leur pratique…
Parlons de la santé au travail. Dans leur livre «Manager les vulnérabilités en pratique», Boutayna Burkel et Charlotte Fortuit-Klein montrent qu’un manager aujourd’hui doit être à l’écoute des signaux faibles, trouver des solu- tions en incluant l’équipe et maintenir le cap sur les objectifs business. La frontière entre vie privée et profession-nelle est-elle devenue plus floue aujourd’hui?
CH: Cette frontière entre le privé et le professionnel s’est brouillée bien avant le Covid. Cela dit, pas tout le monde a envie de parler de sa vie personnelle au travail. Il faut vraiment faire attention. Cela va dépendre des personnalités et il y a encore une ligne rouge à ne pas dépasser.
Et les autres?
RL: Pour moi, c’est un sujet central. Pendant la période du Covid, je suis arrivé dans une situation de saturation personnelle. J’avais créé plein d’entreprises et développé de nombreux projets mais avec quelle finalité? C’est là que j’ai structuré Salu (groupe d’entreprises à visées régénératives, ndlr), avec cette idée de co-créer, co-développer et co-financer des entreprises régénératives pour une santé durable. Quand j’ai commencé à poser le cadre et la vision que j’ai déroulé jusqu’à mes 75 ans, un des points clés était que je ne voulais plus mettre un masque en arrivant au boulot. J’avais beau être entrepreneur, il y avait toujours un «moi» dans la vie privée et un autre «moi» dans la vie professionnelle. J’ai voulu stopper ce décalage. En tombant le masque, j’ai poussé les autres collaborateurs à le faire aussi.
Avec quelles conséquences concrètes?
RL: L’impact concret fut de dévoiler nos vulnérabilités. Les peuples autochtones l’ont toujours pratiqué et nous avons oublié cette manière de faire. Pour eux, plus il y a de vulnérabilités, plus il y a de forces. Je pousse donc à plus de transparence dans toute l’organisation car je sais que derrière les failles de chacun, il y a d’énormes potentiels. Et ce sont ces forces dont nous avons besoin pour réussir professionnellement. Mais cela demande beaucoup d’ouverture, de transparence et de confiance.
Cette ligne entre le privé et le professionnel est aussi devenue floue à cause de la technologie…
RL: Oui bien sûr. Les téléphones, les réseaux sociaux et le télétravail contribuent tous à brouiller les lignes. Du coup, le cadre posé par les RH devient de plus en plus important pour éviter les dérives.
EB: Je peux comprendre que cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle peut être important. Mais créer une frontière rigide entre les deux est uniquement nécessaire si le travail est toxique. Et le sujet sous-jacent est la question de l’alignement entre ce que tu es et ce que tu fais. Dans un monde idéal, les deux devraient se rejoindre. Le travail devrait nourrir notre vie personnelle et l’inverse est aussi vrai. Séparer les deux plans permet de se protéger d’un travail pénible et générateur de souffrance. L’enjeu est plutôt de trouver une harmonie entre les deux.
RC: Oui, complètement d’accord. Et si je reviens à la thématique de cette interview qui est de comprendre comment un RH peut accompagner au mieux un manager, les RH doivent former les managers à accueillir les vulnérabilités individuelles, à détecter les signaux faibles et à sentir les moments où un collaborateur risque de décrocher. Mais tout est dans la raison. L’entreprise ne doit pas devenir un lieu de thérapie collective. Elle doit rester un lieu d’exigence bienveillante. Un manager ne peut pas porter la responsabilité mentale de ses collaborateurs. Je vois des parallèles avec le bonheur au travail, qui est une notion intangible, impalpable et très complexe. Attribuer au manager la responsabilité du bonheur de ses équipes, c’est le placer dans une impasse: il devient comptable d’un état émotionnel qui lui échappe par définition. Donnons plutôt les outils au manager pour être bientraitant, maîtriser l’art du feedback, la capacité à mener des conversations difficiles et à instaurer un cadre de sécurité psychologique.